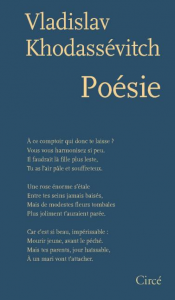
VLADISLAV KHODASSÉVITCH
POÉSIE
(1907-1934)

Polonais par son père, juif par sa mère, Vladislav Khodassévitch voit le jour à Moscou le 16 mai 1886. Son premier recueil Jeunesse paraît en 1908, mais c’est avec Tel le grain (1920) qu’il se révèle comme un poète singulier qui, soucieux de rester « fidèle au sens », affine une forme à la fois élaborée et précise, parfaitement maîtrisée dans son orchestration verbale et prosodique. Au sein de la mouvance postsymboliste russe où dominaient les avant-gardes (acméisme, futurisme, imaginisme), cette poésie au phrasé « néoclassique », en même temps si moderne dans son rapport acéré au monde, à un « siècle cruel », fait de Khodassévitch un maillon incontournable de la lignée pouchkinienne, ainsi que le relevait Vladimir Nabokov dès 1939. Le 22 juin 1922, il quitte la Russie en compagnie de Nina Berberova, future auteure de l’Accompagnatrice. Après Berlin et la villa de Gorki à Sorrente, ils s’installent à Paris en avril 1925. C’est là que le poète succombe à un cancer, le 14 juin 1939.
Parmi les poètes de la grande pléiade russe du XXe siècle, Khodassévitch sera le dernier à « rentrer » en Russie, en 1989, avec une édition complète de ses poésies. Cependant, alors qu’il a retrouvé sa place de premier plan, aux côtés de Mandelstam, Tsvetaïéva, Pasternak, Akhmatova ou Essénine, il demeure largement méconnu dans le monde francophone. C’est à combler cette lacune que s’attache la présente anthologie bilingue.
La première partie reprend tel quel son dernier recueil, La Nuit européenne (1927), où il promène dans l’exil, notamment à Berlin et Paris, un regard désenchanté et lucide, souvent ironique, qui fut toujours le sien. Il n’écrira presque plus de poésie par la suite. La deuxième partie présente un florilège de ses quatre livres antérieurs, avant tout Tel le grain (1920) et Lourde Lyre (1922), ainsi que des poèmes non publiés du vivant de l’auteur.
« J’avais lu un de ses livres en 1968 dans l’appartement de Brodsky et me souvenais qu’en pleine solitude j’avais soulevé une épée appartenant à Joseph afin de saluer les plus beaux vers de Khodassévitch. Je pouvais à présent mieux connaître son œuvre. Sa poésie pertinente, acérée, stoïque, moderne et en même temps impeccablement classique avait pour moi autant d’importance que Pasternak, Mandelstam et Akhmatova »
Tomas Venclova, « Der magnetische Norden »
L’acrobate
Légende pour une silhouette
Entre deux toits une corde est tendue.
L’acrobate avance, calme et têtu.
Dans sa main, la perche telle un fléau ;
En bas, le nez en l’air, tous les badauds.
On se pousse, on murmure : « Il va tomber ! »
Et chacun le regarde, un peu inquiet.
À droite, une vieille à sa fenêtre l’épie,
À gauche, un fêtard au verre rempli.
Mais clair le ciel, et ferme le filin,
L’homme y avance, léger et serein.
Et si soudain quand même il décrochait
Et la foule hypocrite se signait,
Passe donc, poète, sans te troubler :
N’avez-vous pas tous deux le même métier ?
1913/1914
La guenon
Il faisait trop chaud. Les forêts brûlaient. Le temps
Se traînait. Dans le jardin d’à côté
Un coq chanta. Poussant le portillon,
Je vis sur un banc, appuyé à la clôture,
Un Serbe errant qui somnolait, maigre et noiraud,
Une lourde croix d’argent suspendue
Sur sa poitrine découverte. La sueur
Y roulait en gouttes. Plus haut, sur la clôture,
Une guenon en jupon rouge était perchée
Et mâchait avidement les feuilles poussiéreuses
Du lilas. Un collier de cuir
Tiré en arrière par une chaîne
Lui serrait fort la gorge. M’ayant entendu,
Le Serbe ouvrit les yeux, essuya la sueur
Et demanda de l’eau. Mais sans presque y tremper
Ses lèvres – trop froide ? –, il posa la tasse
Sur le banc. Et aussitôt la guenon
Trempa ses doigts dans l’eau, puis à deux mains
S’empara lestement de cette tasse.
Elle buvait agenouillée, la tête droite,
Ses coudes appuyés au banc. Les planches
Effleuraient presque son menton,
Derrière le crâne dégarni on pouvait voir
S’arquer son dos. Ainsi jadis, sans doute,
Darius agenouillé buvait dans une flaque
Du chemin, le jour où il dut s’enfuir
Devant la puissante phalange d’Alexandre.
Ayant tout bu, la guenon balaya
Du banc la tasse, se mit debout sur ses pattes
Et – oublierai-je jamais cet instant ? –
Me tendit une main noire et calleuse,
Qui gardait encore la fraîcheur de l’eau…
J’en ai serré des mains de jolies femmes,
De poètes et de chefs, mais aucune
N’était ainsi empreinte de noblesse, aucune
N’avait si fraternellement touché ma main !
Et jamais personne, Dieu m’est témoin,
Ne m’avait regardé avec tant de sagesse
Au fond des yeux, au fond de l’âme même.
La pauvre bête ranimait en moi
Les douces légendes des temps anciens,
Et à cet instant toute la vie reprit sens,
Et j’entendis le chœur des astres et des flots,
Les orgues du vent et des sphères
Faisaient irruption en moi comme avant,
Comme aux jours lointains, révolus.
Le Serbe s’en alla, frappant son tambourin.
Bien assise sur son épaule gauche
La guenon se balançait en mesure,
Ainsi qu’un maharadjah sur son éléphant.
Un énorme soleil couleur framboise,
Privé de ses rayons,
Restait suspendu dans la brume opale.
La canicule sans orage
Se déversait sur les blés rachitiques.
Ce jour-là, la guerre fut déclarée.
1918-1919
An Mariechen
À ce comptoir qui donc te laisse ?
Vous vous harmonisez si peu.
Il faudrait là fille plus leste,
Sans ton air pâle et souffreteux.
Une rose énorme s’étale
Entre tes seins jamais baisés,
Mais de modestes fleurs tombales
Plus joliment t’auraient parée.
Car c’est si beau et immuable –
Mourir jeune, avant le péché.
Mais tes parents, inébranlables,
D’un mari voudront te doter.
Et lui, un brave et honnête homme,
Fera ployer sans qu’il y pense,
Ainsi qu’une bête de somme,
Ta brève et fragile existence.
Il vaudrait mieux – mais j’ose à peine
Effleurer ces pensées en moi –
Qu’un misérable te malmène
Un soir sans lune, au coin d’un bois.
Il vaudrait mieux que honte et mort
En un moment vers toi s’élancent,
Que se mêlent dans un accord
Deux souillures, deux putrescences.
Robe froissée, tu serais là,
Couchée dans la boulaie déserte,
Un couteau sous ton sein lilas,
Sous ton sein gauche de fillette.
20-21 juillet 1923
Berlin
Face au miroir
Nel mezzo del cammin di nostra vita
Moi, moi, moi… Quel mot vain et barbare!
Cet homme-là, est-ce moi vraiment ?
Est-ce lui que chérissait maman :
Tête à demi chenue, teint blafard,
Et omniscient comme le serpent ?
Le gars qui, l’été, entrait en lice
Aux bals des estivants de Moscou,
Est-ce lui dont les mots à tout coup
Inspirent aux poètes novices
La haine, l’effroi et le dégoût ?
Celui qui la tête la première
Plongeait dans les joutes de minuit,
Est-ce le même qui aujourd’hui
Sait fort bien plaisanter et se taire
Face aux propos pleins de tragédie ?
Mais au milieu du chemin sur terre
C’est toujours de même qu’il advient :
De cause futile en petit rien
Te voici perdu dans le désert,
Sans pouvoir trouver tes pas anciens.
Non, à Paris dans cette mansarde
Nul fauve à grands bonds ne m’a jeté.
Et pas de Virgile à mes côtés,
Mais la solitude – dans le cadre
Du miroir qui dit la vérité.
1924
Lire ici le texte de Vladimir NABOKOV sur Khodassévitch
