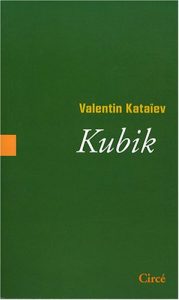
Valentin KATAÏEV (1897-1986)
Roman
Traduit du russe par Henri Abril

Kubik, le cube dans ses nombreuses acceptions en russe, les trois dimensions de l’espace et du temps, la fragmentation détaillée et transcendante de la mémoire cubiste, mais aussi un caniche parisien trop gâté, ultime avatar du barbet de Faust.
« Non pas un roman ou une nouvelle, ni un essai ni un journal de voyage, mais simplement un solo pour basson et orchestre » : l’auteur définit ainsi lui-même ce texte constamment à la recherche d’un effet de présence presque magique, né du son originel, du mot-psyché.
Kubik est un des récits clés de la nouvelle prose « mauviste » par laquelle Valentin Kataïev tenta de rompre, à partir des années 1960, avec le réalisme socaliste toujours ambiant. Arthur Miller parlait plus simplement, à propos de ce roman, de la « quête lyrique d’une enfance, d’une innocence perdue », qui va entraîner deux Russes exilés à travers l’Europe, de Paris à Odessa, en passant par l’Allemagne, la Roumanie et la Bulgarie, l’évocation de Luther et Goethe, Tolstoï, Bounine et Mandelstam…
Sophie Deltin (Le Matricule des Anges, 2008) :
« Né à Odessa en 1897, Valentin Kataïev assura longtemps sa carrière comme écrivain soviétique. Jusqu’à écrire « Kubik », où avec la liberté pour seul enjeu, il osa débrider son don d’imagination. Dans ce court récit que Valentin Kataïev présente lui-même non pas comme » un roman ou une nouvelle, ni un essai ni un journal de voyage, mais simplement un solo pour basson et orchestre « , le matériau sonore est bien ce qui met en branle l’écriture, l’irrigue, et lui intime sa coloration fantastique, presque palpable, autant que son rythme, incantatoire et ralenti parfois – comme au bord de l’éternité. Son d’un petit tapage de rue, son d’une eau minérale allemande, celui d’une guêpe écrasée ou celui, » vivant, chaud « , d’une respiration humaine… » Je ne cesse de vibrer tel un résonateur, en vient à préciser l’auteur, un appareil magique qui reçoit de partout, dans l’espace universel, des milliards de signaux qui, à une vitesse inconcevable, foncent vers mon pauvre corps, vers ma tendre et si frêle Psyché. » C’est peu dire la rupture qu’opéra, en plein » dégel » khroutchévien, le geste de Valentin Kataïev : celui qui, couronné du prix Staline en 1946, fut longtemps l’un des écrivains officiels du réalisme socialiste (il ira jusqu’à participer à la campagne de dénigrement contre Boris Pasternak et Alexandre Soljenitsyne), place ici explicitement son texte sous le signe des figures tutélaires que sont devenus pour lui Ivan Bounine (prix Nobel de littérature en 1933) et le poète Ossip Mandesltam. Tel un hommage tardif (aux allures de repentir) adressé à ces deux réprouvés du régime soviétique, l’auteur a à coeur de se lancer à la recherche d’un » effet de présence « , quasi magique, tiré du son originel, du mot-Psyché, dont il emprunte la conception à ses Maîtres – : » L’essentiel pour moi c’est de trouver le son, dit un jour Bounine. Une fois le son trouvé, tout le reste coule de source. » Chez Kataïev, le son mnémonique, caché comme un bruit de fond ou une rumeur ininterrompue dans les plis » de ce qu’en physique on appelle le temps « , sera celui de l’enfance : moins un âge ou un état chez lui, que la capacité d’éprouver des sensations premières et la puissance, pleine d’une liberté inarticulée, d’oser, de sortir de soi en se déprenant des frontières, et que l’auteur entreprend ici de ressusciter grâce à » kubik « , dont il joue sur la polysémie du terme en russe : » Un petit cube de plexiglas. Lanterne magique. Effet de présence. Oeil mort. Une pupille » par où l’on peut revisiter ce qui nous rattache à ce qu’il y a de plus insaisissable en elle – le songe, et sa force impressive sur les êtres ou les choses. Dans ce texte insolite, espiègle, quoique tout empreint d’une gravité rentrée, il n’y aura ainsi pas d’histoire à strictement parler – un des axiomes de ce courant » mauviste » au nom duquel Kataïev prône avec zèle l’émancipation de toutes les conventions littéraires usuelles – mais plusieurs bouts d’histoires, un brin saugrenues pour la plupart (un petit caniche gâté en proie à de furieuses envies de mordre, un garçon de café parisien sur les barricades de mai 68), des légendes aussi (le geste de Luther qui, en pleine traduction de la Bible, aurait lancé son encrier à la face du Diable), ou des rêveries scandées par des images poétiques. Ainsi de ce motif qui insiste comme une mélodie, et symbolise à lui seul le » miracle » de l’enfance : une montgolfière en papier à cigarette qui, dans » un instant de divin équilibre « , s’élève » lentement vers le ciel engourdi « , poursuit son ascension vers la haute mer, jusqu’à s’enflammer au moindre souffle de brise marine… De cet objet littéraire franchement original, paru en URSS en 1969, le lecteur d’aujourd’hui pourra se figurer l’étrangeté en pensant au mécanisme du rubik’s cube – ce casse-tête géométrique à trois dimensions inventé par un Hongrois en 1974, qui permet de faire pivoter ses faces à l’infini pour obtenir toujours de nouvelles couleurs et de nouveaux agencements. Loin donc de s’échiner à vouloir trouver la » résolution » magique de cette histoire qui ne s’embarrasse pas d’en être une, il s’agit plutôt de se prêter au mouvement du jeu, notamment celui de Pchelkine et Sania, deux enfants » tout neufs » au bord de la mer Noire peu avant la Première Guerre mondiale, quitte à passer par ce moment » fatidique » où l’innocence commence à se flétrir, à cause de lettres mystérieuses et de trésors fabuleux. Et si l’adulte reste à jamais cet » ex-garçon » ou cette » ex-petite-fille » ensevelis tel un cadavre incorruptible en lui, ce n’en est pas moins l’avènement de » l’amertume secrète d’où viendra le reste » en même temps que le début de l’errance : celle d’une » âme nomade et sans âge » qui à l’instar du » mot (…) autour de la chose » (Mandelstam), s’en va se réincarner ailleurs, dans l’espace et le temps, selon un mouvement de métamorphoses perpétuel… Le livre de Valentin Kataïev n’a pas seulement le charme prenant du récit qui se mord la queue, il possède aussi une sorte de clarté inquiète, brûlant d’une fièvre invisible, qui peut alors s’épargner d’aller directement au sens. Son style coulé dans des atmosphères à la fois concrètes et irréalistes ( » Autour des deux enfants tout avait cette couleur pénible du calme plat, même la lune pleine paraissait dessinée à la craie dans le ciel diurne. « ), et servi par des phrases qui souvent font advenir l’effroi de l’infini ouvert devant elles, déploie au final, une singulière capacité d’immensité ».
