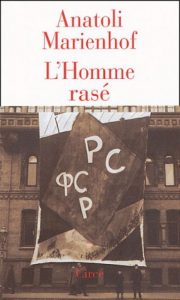
Anatoli MARIENHOF
Roman
Traduit et préfacé par Henri Abril
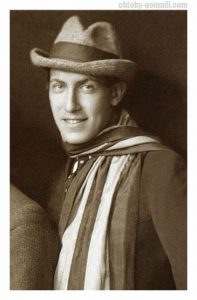
(La transcription des noms russes n’est pas toujours évidente en français : faut-il écrire, par exemple, Essénine ou Iessénine, Mandelchtam ou Mandelstam, Kharms ou Harms, Marienhof ou Mariengof ? Contrairement à une pratique plus ou moins établie, j’ai ici opté pour l’origine historico-linguistique du nom et son « étymologie » mariale si importante aux yeux du poète, lequel, au demeurant, avait lui-même opté pour le « h » quand il lui arrivait d’écrire son nom en caractères latins. Selon certains témoignages, Marienhof et d’autres prononçaient son nom avec un « g » dialectal, entre « g » et « h » aspiré. Ajoutons que les éditions allemandes, polonaises ou baltes restituent naturellement « Marienhof »)
PRÉFACE
N’est-il pas amusant
Que mon premier cri ait retenti
À Nijni Novgorod, rue du Môle-aux-Ecorces ?
C’était en 1897 la nuit
De la Saint-Jean
Alors même
Que la fougère fleurit
Dans la fosse du diable.
Dès l’âge de huit ans
Je me suis mis à tailler
Une bavette d’argent.
De là tous mes malheurs.
Mon nom me fut donné à la naissance,
Et tout le reste ensuite.
Etc., etc.
De cet Et cetera, sur lequel s’achève un poème écrit au tournant de 1919-1920, va naître la prose d’Anatoli Marienhof que certains n’hésitent plus, aujourd’hui, à placer au côté de celle de la pléiade des années vingt : Pilniak, Babel, Zamiatine, Olécha, Platonov. Mais avant d’en arriver là, Marienhof aura dû passer par le creuset de la poésie.
Khlebnikov le visionnaire avait fait richement rimer, en 1920, le nom de Marienhof avec le Golgotha : Golgofa / Mariengofa. Trois morts tragiques allaient ponctuer ce calvaire. La première fut celle du père à qui Marienhof avait été particulièrement attaché, surtout après la disparition prématurée de sa mère, et qui exercera sur lui une forte influence, littéraire y comprise. Boris Marienhof était d’origine balte, ou plutôt germano-balte, une légende faisant remonter la lignée aux chevaliers Porte-Glaive (mais selon d’autres sources, seul le grand-père ou l’arrière-grand-père de Marienhof aurait été adopté par un baron de Courlande qui lui donna son nom). Lui et sa femme jouèrent sur des scènes provinciales avant de se fixer à Nijni Novgorod pour donner une bonne instruction à leur garçon, puis à leur fille. Cette passion du théâtre, ainsi que le goût des auteurs classiques russes et allemands, sera transmise à Marienhof, « condamné de naissance », disait-il, à épouser une comédienne et à écrire des pièces. Sans doute le père avait-il une certaine fortune puisqu’il deviendra actionnaire de la compagnie anglaise Grammophone, étant aussi son représentant en Russie centrale. Et Anatoli Marienhof aura droit à une excellente éducation, d’abord à l’Institut Alexandre II de Nijni Novgorod qui n’admettait que les rejetons de la noblesse, puis au Gymnase Ponomariev, un collège privé de Penza où les Marienhof s’installèrent en 1913 après que la mère eut été emportée par un cancer de l’estomac.
C’est sous l’influence d’Alexandre Blok, qui régnait alors presque sans partage en Russie, que Marienhof a découvert la poésie et écrit ses premiers vers en 1908. Il faudra les conseils paternels (le garçon ayant écrit « Hymne à une hétaïre », son père le presse de le changer en « Hymne à une putain » : « C’est plus exact, et au moins c’est en russe ») et surtout l’apparition des futuristes pour que Marienhof se débarrasse du symbolisme et assume sa vocation. Le tournant semble s’être opéré en 1914, lorsque Marienhof publie au collège une revue hectographiée, Mirage, où il est l’auteur de la plupart des poèmes, récits et essais. En 1918, il sera aussi le principal pourvoyeur de l’« almanach révolutionnaire » L’Issue, dont il emporta bientôt une pleine valise d’exemplaires en partant à la conquête de Moscou. Le prétexte immédiat de ce départ était la mort du père, tué sur le toit de son immeuble, en pleine canicule, par une balle perdue (Marienhof le raconte en détail dans son Autobiographie de 1930, ici reprise en annexe).
Marienhof dira plus tard que l’Issue fut le premier produit de l’imaginisme, et il est indéniable que le métaphorisme débridé de la nouvelle école s’annonçait dans certains poèmes de son premier livre La Vitrine du cœur, paru à Penza en cette même année 1918 : « L’amour arraché de mon cœur / Je le porte dans mes paumes / Prends-le vite / Comme la tête d’Holopherne »… On voit bien ici tout ce que l’imaginisme doit au futurisme, et rien d’étonnant que ce soit par rapport à lui qu’il ait d’abord et surtout cherché à marquer son terrain dans le champ de la foisonnante avant-garde russe. Les quatre fondateurs de l’Ordre des Imaginistes, en janvier 1919, avaient convergé vers le même point par des voies différentes, indépendamment l’un de l’autre, et l’on peut discerner dès le début, comme le fera a posteriori M Roizman, une division en aile « gauche » des urbanistes (Marienhof, Cherchénévitch) et aile « droite » des ruralistes (Essénine, Ivnev), qui portait en germe toutes les contradictions, notamment dans le rapport à l’art et à la révolution, ainsi que la rupture survenue dès 1923-1924.
Au « mot en tant que tel » du futurisme, les imaginistes voulaient opposer « l’image en tant que telle » (mais Maïakovski, Khlebnikov ou Kamenski n’avaient jamais rejeté la métaphore, bien au contraire). Leur Déclaration, manifeste inaugural publié le 30 janvier 1919 dans la Sirène de Voronej, affirmait tout de go : « Nous sommes les véritables artisans de l’art, nous sommes ceux qui affinent l’image pour débarrasser la forme de la poussière du contenu… Nous affirmons que la loi unique de l’art, la seule méthode consiste à révéler la vie à travers l’image et le rythme des images… L’image, rien que l’image. L’image seule, comme une naphtaline recouvrant l’œuvre, peut sauver celle-ci des mites du temps. L’image est l’armure du vers, la cuirasse du tableau. »
Pour ce qui est de Marienhof, il écrivait en mai 1920 dans L’Île Bouyan (venue du folklore russe, cette île « effervescente » incarnait en quelque sorte la primauté de l’imaginaire sur la réalité, à laquelle elle donnait un sens nouveau) :
« Ce n’est pas l’art qui craint la vie, mais l’inverse, étant donné que l’art est toujours porteur de mort, et ce n’est évidemment pas au mort de redouter le vif. Les guerriers de l’art sont une troupe morte. Aussi l’art est-il éternel dans sa mort, alors que la vie est toujours finie. L’attouchement de l’image poétique suffit à figer le sang des choses et des sentiments…
La révolution cesse d’exister dès lors qu’elle s’incarne dans une image artistique. La naissance de la Marseillaise engendra la mort de la révolution française. La chance immense de la révolution russe est d’avoir prémuni ses artères contre les piqûres de la plume poétique. Les poètes n’ont pas encore versé son sang brûlant dans le verre froid de leur encrier…
La continuation du genre humain n’est pas menacée tant que l’acte sexuel sera dominé par la laideur. Seuls les déments peuvent encore croire à l’amour. Mais puisque les poètes, les peintres, les musiciens sont les plus lucides sur terre, l’amour n’existe chez eux qu’en poèmes, en marbre, en couleurs et en sons. L’amour est un art. Et lui aussi pue le cadavre…
La vie peut être morale ou immorale. L’art n’est jamais ni l’un ni l’autre. C’est là une antique vérité qu’il convient de rappeler en toute occasion. Un pieu que l’on ne cesse, depuis deux siècles, d’affûter sur le crâne des imbéciles…
Il ne m’appartient pas de séparer le pur de l’impur dans le verbe ou l’image. Vissarion Biélinski écrivait déjà en des temps anciens : “N’est-ce point le même Esprit divin qui a créé le doux agneau et le tigre sanguinaire, la belle Tcherkesse et le Nègre affreux ? Aime-t-il davantage la colombe que l’épervier, le rossignol que la grenouille, la gazelle que le boa ?”
Mais on va certainement me demander pourquoi la poésie métaphorique moderne cherche délibérément, en quelque sorte, à accoupler dans l’image le pur et l’impur. Pourquoi chez Essénine « le soleil s’est figé comme la flaque où un hongre se délesta », ou bien « l’aube lève sa queue, telle une vache, au-dessus des bois » ; pourquoi chez Vadim Cherchénévitch « le gonocoque du rossignol ne peut pas être soigné par l’urine trouble de la lune ». L’un des buts du poète est de provoquer chez le lecteur un maximum de tension interne. D’enfoncer l’écharde de l’image le plus profondément possible dans la paume perceptive du lecteur. Ces croisements du pur et de l’impur contribuent à aiguiser les échardes dont la poésie imaginiste moderne est hérissée comme il se doit.Il convient aussi de se demander si de tels accouplements du « rossignol » et de la « grenouille » ne donnent pas l’espoir d’enfanter une espèce nouvelle, de diversifier la race de l’image poétique…
Qu’est-ce que l’image ? La distance la plus courte à la vitesse maximale. Quand la lune est directement sertie dans une bague enfilée sur l’auriculaire gauche, quand un clystère à l’eau médicamenteuse rosâtre vient se suspendre à la place du soleil… L’œuvre poétique, habilitée à se nommer poème et représentant une image très élargie, peut être comparée à un système philosophique cohérent — sans que la poésie ne s’impose des tâches philosophiques proprement dites —, et les images en rangée compacte, épaule contre épaule, sont assimilables à des traités philosophiques dont la somme constitue un système. La compression extrême de la poésie imaginiste réclame une tension extrême de la part du lecteur : il suffit qu’un maillon se perde pour que toute la chaîne des images en soit brisée. Si la totalité artistique voit se désintégrer sa forme rigoureuse, il n’en restera qu’un monceau brillant, voire admirable, mais cependant chaotique ; c’est de là que vient l’apparente obscurité de la poésie métaphorique moderne.Le fait est que le mot, le discours et le langage naissent du ventre de l’image…
Il est absurde de considérer la poésie du point de vue de l’idéologie — prolétarienne, paysanne ou bourgeoise —, aussi absurde que de vouloir définir la distance en livres ou grammes. Il s’agit d’une erreur qui vient des affinités apparentes des mots, de leur vaste consommation dans des circonstances qui n’ont rien à voir avec l’art. Il en est du mot inséré dans la forme poétique comme, par exemple, du pavé qu’un maître a poli et enchâssé dans une bague : ce n’est pas l’essence du matériau qui a changé mais sa destination, l’objet de l’utilité est devenu un objet du beau… Comment ne pas se souvenir de l’épisode d’une farce jouée à Saint-Pétersbourg à la cour d’Anna Ioanovna : Arlequin soignait la toux sèche de Pantalon avec un clystère, ce à quoi l’autre répliqua sagement : « C’est par devant que je tousse, pas par derrière ». L’art était malade dans sa forme mais on s’obstinait à le soigner avec le clystère de l’idéologie…».
Si nous avons cité d’aussi larges extraits du principal texte « théorique » de Marienhof, c’est qu’il nous épargne le vain effort de la paraphrase. Conceptions des imaginistes, passerelles vers d’autres courants, passés ou contemporains, russes ou étrangers, parfum de l’époque, des premières années de la révolution, thèmes-clés et obsessions de Marienhof : tout y est. Plus que de sa propre poésie, somme toute mineure dans les confins de l’âge d’argent de la poésie russe, c’est de l’esthétique, de la poétique sous-tendant sa prose et, en premier lieu, celle de L’Homme rasé, qu’il est question dans ce texte essentiel. Cette prose écrite en quatre ans à peine, entre 1926 et 1929, et qui place, répétons-le, Marienhof parmi les grands auteurs russes du vingtième siècle, le poète la portait depuis longtemps en lui et il en accoucha comme une délivrance. L’étincelle en fut sans doute aucun la « deuxième mort »du Calvaire de Marienhof : le suicide de Sergueï Essénine en décembre 1925.
Les deux poètes, enlacés comme les ailes de l’imaginisme, étaient devenus inséparables depuis 1919, au point de partager leur chambre et leur lit, allant par provocation jusqu’à afficher en public une relation peu banale, comme lorsque, à l’indignation générale, ils publiaient leur correspondance parfois intimiste (et qui aujourd’hui fleurit sur les sites gays de l’Internet russe) ou s’embrassaient à pleine bouche dans les cabarets moscovites. Leur rupture provoquée par un malentendu faillit se produire dès la fin de 1923, mais, bien qu’ils eussent été réconciliés tant bien que mal, leur amitié cessa d’exister, surtout après qu’Essénine se fut empressé d’annoncer dans la Pravda la fin de l’imaginisme. Il n’empêche que le suicide survenu à l’hôtel Angleterre de Léningrad bouleversa d’autant plus Marienhof que d’aucuns lui reprochaient d’avoir « abandonné » Essénine et précipité sa mort. C’est toutefois moins pour s’expliquer que pour faire le bilan de la première moitié de sa vie qu’il entreprend alors d’écrire le Roman sans mensonge.
On a pu parler de prose « autobiographique » au sujet de Marienhof, mais plutôt que d’exposer fidèlement les faits, il s’agissait de retrouver l’essence profonde de la réalité, quitte à « dérider la surface », comme il le disait lui-même. La déviation, la déformation subjectiviste, délibérée et souvent même outrancière, lui apparaissait nécessaire dans la mesure où c’était le « meilleur moyen de restituer à l’image sa signification originelle par-delà les scories du quotidien ». « L’écrivain par la grâce de Dieu n’a nul besoin d’être exact », écrivait de son côté Vadim Cherchénévitch. Et Rurik Ivnev de lancer : « L’objectivité pue ! » (Ce qui ne l’empêchera pas de s’offusquer des propos « mensongers et calomnieux » de Marienhof à l’égard d’Essénine). Mais dans ce premier roman les noms réels faisaient encore « obstacle au développement de l’image », et c’est dans ses deux proses suivantes, Les Cyniques et L’Homme rasé, que Marienhof va pouvoir réaliser pleinement l’« esthétique du masque » (terme de Cherchénévitch) chère aux imaginistes, laquelle va de pair avec une exacerbation des procédés métaphoriques et rythmiques. Déroulant ses images surprenantes qui tiennent à la fois de Gogol et d’un expressionnisme surréaliste, construisant son récit à la façon du montage eisensteinien (il s’intéressait depuis longtemps au cinéma et, devenu responsable de la section des scénarios à Proletkino, les studios Cinéma prolétarien, il avait commencé à écrire lui-même des scénarios de films), Marienhof parvient à condenser dans la brève fiction « autobiographique » de L’Homme rasé une période décisive du vingtième siècle russe, depuis la veille de la Première guerre mondiale jusqu’en 1929, l’année du « grand tournant » stalinien. Conscient d’écrire son chant du cygne, il y exprime de façon fulgurante la plupart des thèmes qui lui tenaient à cœur : l’enfance et le monde adulte, la création, l’amour et l’amitié, la trahison, la femme et la laideur des actes, la guerre, la littérature et l’histoire, l’angoisse existentielle et la révolution, bref, la destinée exceptionnelle de l’âme russe que, vers la fin du roman, il résume dans une métaphore élaborée de l’homme rasé. L’art de l’anecdote, auquel Marienhof voulait donner ses lettres de noblesse, atteint par là même au tragique universel.
Ce livre, comme Les Cyniques deux ans auparavant, Marienhof dut le publier aux éditions russes Petropolis de Berlin, en 1930. Violemment pris à parti, au côté d’Evguéni Zamiatine qui lui aussi avait « osé » publier à l’étranger un roman « antisocial », il va envoyer un « mea culpa » à l’Union des écrivains et surtout devoir garder un profil bas durant les années trente. Il se consacre alors presque entièrement à l’écriture de scénarios et de pièces de théâtre, de saynètes, mais aussi à la prose historique, puisqu’il lui était interdit d’écrire sur son temps. Il réussira à publier en 1936 plusieurs chapitres sur l’enfance et l’accession au trône de Catherine II. Deux de ses pièces seront jouées dans les années quarante, deux recueils de poèmes sur la guerre paraissent en 1942, mais une troisième tragédie est venue le frapper entre-temps. Le 4 mars 1940, son fils Kirill se donna la mort, refusant de vivre dans une époque d’« absolutisme non éclairé ». Ce jeune homme très doué disait à son père : « La littérature avec un doigt sur les lèvres ? Ha-ha ! Quelle ineptie ! Finis-en, papa, c’est sans espoir… »
L’espoir revint cependant à Marienhof après la mort de Staline. Dès 1953 il se remet à la prose autobiographique et termine en 1956 Mon siècle, ma jeunesse, mes amis et amies. Mais toutes les tentatives de le publier échoueront malgré le dégel khrouchtchévien. Une version fortement édulcorée en parut en 1965, trois ans après la disparition de Marienhof, dans deux numéros de la revue Oktiabr (Octobre). Le texte intégral devra attendre la perestroïka, en 1988. Quant à L’Homme rasé, que Boris Eichenbaum, le grand théoricien de la littérature, qualifiait de « pur joyau » dès 1931, il n’a été publié pour la première fois en Russie qu’en 1991.
Né le 24 juin ancien style (calendrier julien), Anatoli Marienhof s’est éteint le 24 juin nouveau style (calendrier grégorien), en bouclant par une ultime et ironique révérence le « claudicant destin » qui, affirmait-il, lui fut attribué à la « cour de Marie ».
***
Thierry Cecille (Le Matricule des Anges, juin 2008) :
« Dernier dandy de la révolution soviétique, Anatoli Marienhof nous offre un kaléidoscope d' »enfantaisies » au coeur du totalitarisme. À intervalles irréguliers ressurgissent, de quelque trou noir de la censure soviétique, des chefs-d’oeuvre oubliés, étoiles trop rapidement filantes. L’Homme rasé est de celles-là, et il faut remercier les éditions Circé et le traducteur-préfacier Henri Abril de nous permettre cette (re)découverte. Marienhof fut d’abord le complice du poète Essenine – et son amant ? en tout cas ils le laissèrent penser, rejouant Verlaine-Rimbaud sur un air d’agit-prop… Poète » imaginiste « , il voit dans la métaphore l’arme spirituelle par excellence, » la distance la plus courte à la vitesse maximale « , capable » d’enfoncer l’écharde de l’image le plus profondément possible dans la paume perceptive du lecteur « , mais il ne saurait être question de la mettre au service de quoi que ce soit, pas même des lendemains qui s’efforcent de chanter. Après Baudelaire et au même moment que Breton, il réitère : » La vie peut être morale ou immorale. L’art n’est jamais ni l’un ni l’autre. C’est là une antique vérité qu’il convient de rappeler en toute occasion. Un pieu que l’on ne cesse, depuis des siècles, d’affûter sur le crâne des imbéciles ». Mais si l’imbécile en question se fait appeler Staline, petit père des peuples ? S’éloignant peu à peu d’Essénine et de la poésie, Marienhof écrit entre 1926 et 1929 trois romans, dont cet Homme rasé qui ne put paraître, en 1930, qu’à Berlin. Il se fera ensuite, jusqu’à sa mort, d’une discrétion prudente, se contentant d’écrire des scénarios et de modestes pièces, que la censure guettait. Nul doute que pour ce roman un autre terme serait sans doute plus juste : fantaisie ? conte noir et grotesque ? n’avait rien qui pût servir la cause de l’élan stalinien : au moment où Stakhanov devient l’Hercule de la construction du socialisme, notre narrateur-anti-héros, lui, se décide à pendre au cordon de la portière son » ami » Léo : » Ce cordon se terminait par un gland très lourd, de la couleur d’un sparadrap, qui se colla aussitôt à sa mâchoire pour lui faire comme une barbe. Il ressemblait à un Assyrien ». Individu » souterrain « , comme il en est tant chez Dostoïevski, affublé d’un nez ridicule comme chez Gogol, il décide, pour tenter d’expliquer son acte, de remonter le temps jusqu’au jour de son adolescence où lui apparut cette idole néfaste, adorée et haïe. Nous voici donc à Penza, bourgade provinciale étriquée et prétentieuse : ressuscitent la tenancière du bordel » avec ses sourcils tels les moustaches de Frédéric Nietzsche « , le maréchal de la noblesse, » toujours gai comme un nombril « , les latrines du collège où les adolescents se lancent d’absurdes défis. » Oh comme le Russe aime toutes les saletés, les cochonneries ! » Puis viennent la guerre, les éclats de shrapnels, » ravissants flocons de neige qui trouaient le ciel « , les cadavres, le communisme de guerre, le premier » tchékiste « . Il faut pourtant bien devenir adulte, accepter les responsabilités et les poses adéquates, et la » philosophie de porc » que tout cela exige. C’est qu’avec la Révolution, l’homme russe, en même temps qu’il a rasé » les favoris inspirés de Pouchkine » ou » la barbe patriarcale de Tolstoï » a rasé son » âme russe » : » nous sommes aujourd’hui les hommes les plus modernes sur terre » ; entre désespoir et cynisme, vodka et saucisson cuit, vivre n’importe pas plus que mourir. Marienhof peut avouer à la fin de sa courte et scintillante autobiographie, ici publiée à la suite du roman : « Si je crois à quelque chose, c’est à l’huile de ricin ».
