
SYLLABAIRE / SI L’AUBE
éditions Contre-Temps, 1993
Empreinte de René-Claude Girault
130 pages
(Poèmes écrits entre 1988 et 1992)
La bouche pleine de boue,
Les yeux mangés,
Pousse ta barque pour nous
Dans la matière
Yves Bonnefoy
2 parties :
AUBE (I) : LA BOUCHE

AUBE (II) : LA BOUE
« J’ai songé à ces textes, longtemps, que nous regardons d’abord comme l’intrus observe les organes du corps en train de se modeler, de se greffer. Matière entée. Il faudrait dire que Henri Abril réussit à assembler les vertèbres du poèmes qui sont dans l’épaisseur du verbe. Alors il le dépèce dans le hasard précis de la page, il le recharge de syllabe en syllabe, lettre à lettre parfois. Il faudrait parler de la germination du mot qui, sorti de la bouche, devient boue – floraison dans les entrailles du poème, effervescence d’une aube.
Pourtant nulle coquetterie dans le placement du mot, car il ne s’agit pas de le faire apparaître mais de donner de sa chair.
autre décor : ce qui s’écrit :
la trace de l’écor
ché dans le ciel
changeant
Pas d’exhibitionnisme mais montrer comme Reverdy, à qui Henri Abril rend hommage, entendait montrer. Que le poème définisse lui-même son espace-langage, fait de matière, d’un tâtonnement du sens, d’un essayage de la langue. Cette poésie s’engouffre dans le siècle et le retourne, pâte et levain sur des hectares innombrables de désastres. Elle arrive à point nommé, syllabaire de l’aube dans lequel l’homme défiguré pourra apprendre, comme on tâtonne dans l’enfer du boulier, à se regarder sans honte. Jamais le « contra spem spero » n’a retenti, du cœur même des mots que lancent les poètes à la face de l’époque, avec une telle netteté, un tel courage, quand, nous rappelle Yves Bonnefoy, notre « bouche est pleine de boue », quand Henri Abril lui répond qu’il s’agit de remonter « des tripes vers la clarté ».
C’est de cette ténacité remontante, de cette force-là, dont je voudrais parler. Il arrive que l’on soit conquis par l’extrême soin de l’autre à s’enfoncer dans la chair même du langage ; Abril est de ceux-là, lui qui fore inlassablement le « dedans » non pour s’y enfermer mais pour lui donner l’ouverture d’un fruit criblé de taches.
On devrait aussi entendre ce que la stimulation propre aux écrivains conscients de leur art fait naître par la figure de la contamination – pour peu qu’ils reconnaissent leur admiration, qu’ils l’avouent, à la lecture de leurs pairs : Marina Tsvétaïéva, Emily Dickinson, mais aussi Quevedo, Homère, Neruda, Cadou, Gongora, Mandelstam… Sans doute Henri Abril a-t-il traduit nombre de poètes russes, de grands poètes, dont il est l’interprète au sens fort, et il « entonne » aussi l’air de leur nom, incorporé parfois dans la substance même du poème. Ainsi de Tsvétaïéva rendue présente non par une quelconque dédicace, comme on en abuse – mais c’est la dédicace (mention intime de l’adresse presque effacée) qui entre à part entière dans le texte.
Alors il y a l’errance, cette perte de sens qui tourne dans le sable de la fable russe, la trace même de la mort dans les linceuls de l’Histoire, ses charniers dont on a longtemps dissimulé les cadavres, le chant des des grands disparus évoqués comme des frères, cette époque, ce siècle tournoyant sur lui-même que l’auteur de Syllabaire / si l’aube « endosse » comme un vêtement de boue, dont il fait sa lumière ».
François Garros (Avant-propos)
EXTRAITS
***
à patricia thompson,
fille de maïakovski
récit femelle
dans la fissure exacte
du temps
ce n’est pas le passage d’un corps
à un autre
qui fait l’émotion et donne
du poids à la récurrence
les suicidés qu’on dé
pècerait sur un linge blanc
quelque part dans l’ohio
ou l’oklahoma
à coups de ciseaux
ou de mémoire bifide
les suicidés n’ont pas le don de fiction
ils sont une jeune bouche
toujours ouverte
suspendue dans nos vies
comme quand on rêve et que la réalité
nous emplit d’un lait tiède
***
(noms / exode, 23)

et l’ange marchait
devant,
mâchant remâchant
les noms hivvites
et jésubéens
syllabes éraillées
rumeurs graisseuses
du jour presque neuf
l’ange marchait
digérant les mille noms
de canaan
sans savoir même
que l’avenir était
inscrit
sur les stèles mâles
de la mer des roseaux
à la mer des philistins
***
hors miroir
pour ivan jdanov
Un jour tu auras fini
de labourer les miroirs
et dans ta langue punique
les mots naîtront – nus et roides
Ni la dulie des faux anges
ni la foule aux airs de coq
mais déjà agonisante
(aux mythes l’âme s’écorche)
n’auront pu clouer d’étoile
sur le front de tes pouliches.
Ni l’hymne des abattoirs
déclamé par l’oiseau-lyre
Toi qui vis dans l’altitude
entant la peau des images
– sainte odeur de pourriture
au lieu même des stigmates –
tu pourras enfin blanchir
pareil à toi comme un mort
victorieux de tous les schismes.
Mais le siècle plein de morgue
avec l’espoir communie,
peuplant nos rêves coupables.
Et dans ta langue punique
les mots naissent : chants, épaves
***
Sur une ode rené guy cadou
toujours le même rituel :
mort dansé
comme on tord un linge
mort grouillant de vocables
dans la nuit perfectible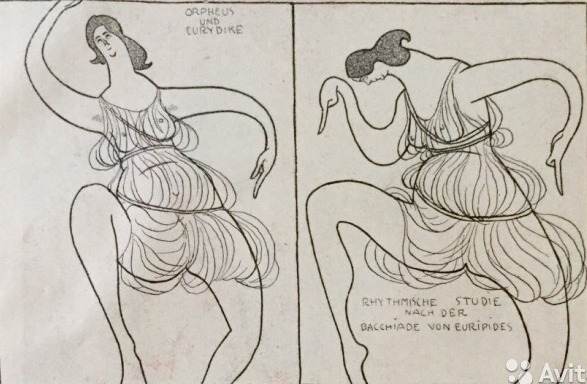
viendra-t-il becqueter
dans nos paumes
avec sa lèvre analogique
titubant, discernable à peine
sous la rumeur des mouches ?
quand le chant s’est répandu
hors les jambes repliées, hors l’axiome
du beau-et-du-vrai,
il n’y a plus de chérubins voyeurs
ni trace des futurs anciens
sur les derniers lambeaux d’un corps
à l’odeur d’églantine et de menthe coupée
(à l’hôtel d’Angleterre)
***
la vierge vêtue de soleil
L’Histoire est tellement
nue qu’elle avance
avec son cortège de viande
et d’os
Autrefois quand j’avais
la peau blanche
et que j’aurais voulu
mourir parce que la russie
éternelle de jour en jour mangeait
ses excréments
j’ai retrouvé soudain mon nom et
la langue de mon nom
dans les mille corps de marie
Et la pensée n’épousait
plus la rate
et ce qui chantait en nous
n’était plus déchiré par
les ongles les dents d’une aube
toujours en gésine
L’âme dit
soloviev remonte
des tripes vers la clarté
