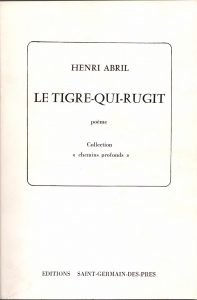
La vie du poète russe Lermontov
narrée par Isidore Ducasse
Poème écrit en 1976-1979
SGP, 1983, 90 pages
(épuisé)
Repères
Adolescent, je voyais en rêve les Grandes-Têtes-Molles, ces anges du doute qui nous avaient rongé le foie et la mémoire, puis boutés hors de la chaîne des temps.
Hermaphrodite-Circoncis, Spectre-Toqué, Homme-en-Jupon, Cigogne-Larmoyante, Funèbre-Echalas-Vert, Suicidé-pour-Rire… sexes visqueux et insipides, flasques phallus tapis dans l’ombre, ô monstres ! Souvent je m’éveillais, les draps souillés de vomissures.

Parmi ces femmelettes lugubres seul le Tigre-qui-Rugit se dressait en colonne de neigeuse lumière. Et je me suis longtemps demandé ce qu’il pouvait bien faire dans cette phalange, coincé entre la Cigogne et l’Echalas. Outre qu’il détonnait par sa présence même, lui seul avait un nom indéchiffrable. Tous les autres étaient plus ou moins transparents, mais le sien me restait obscur tant par la trajectoire terrestre que par l’œuvre du poète.
Ce n’est que plus tard en Moscovie, parlant la langue indigène, que j’ai compris, à suivre les traces de L. et à le lire, qu’il ne pourrait porter d’autre nom que celui dont Isidore Ducasse le baptise dans la première livraison des Poésies.
Pourtant, l’énigme demeurait entière : comment le Montévidéen, ignorant le russe, avait-il pu pénétrer ainsi les tropes et les entrailles de L. ? Poe, Goethe, Byron et même Mickiewicz, cela se conçoit. Mais Lermontov !
Vint enfin le jour où, gravissant la pente de l’Elbrouz, je croisai le signe invertisseur qui règle nos destins. Tout s’éclairait :
l e r m ö t o V
/ l o t r e A m ö

Cinq ans après la disparition du Slave, naquit celui qui serait son anagramme phonologique articulée par l’inversion de l’écriture latine (V-A), tout comme par la continuité cyrillo-numérique ou latino-cyrillique (B-A).
« J’aurais voulu être plutôt le fils du Tigre », avouait Lautréamont dans le premier Chant. Il l’était. Et il le fut bien plus encore du fond de son deuxième avènement. De la mort de l’un au pied du Machouk à la naissance de l’autre sur les rives du fleuve-océan, de DéMon en MalDoror, de cœurs classico-romantiques inversés dans le sexe en élans de l’âme tels des turgescences, d’échos en échos dans la chair de ce siècle (ô Pasternak, ô Tsvétaïéva) et au creux de moi-même, les rugissements du Tigre ont rebondi à travers le temps.
Ç’aurait pu être la vie de Michel Lermontov narrée par le comte de Lautréamont, ânonnée par le muchacho Isidoro – mais la poésie n’est-elle pas le lieu privilégié où le sens échappe à l’histoire ? Et j’ai lâché les Voix pour qu’elles essaiment dans une lumière jamais finissante.
***
Le poème est composé des 27 saisons de la vie de Lermontov (1814-1841 : encore une inversion nullement fruit du hasard) et peut se lire de deux façons, soit en suivant l’ordre successif dans le livre, soit selon l’ordre chronologique indiqué par la table en fin de volume.
Extraits du poème : deux de ces 27 saisons
Vox populi
― Il battait des bras tel un papillon de verre
― La vie enfin s’était ouverte
― Nulle écume sur son corps, nul signe
― Mais cette algue de chair à son front obscurci ?
 ― Était-il plante ou loutre inhumaine ?
― Était-il plante ou loutre inhumaine ?
― C’est l’ennui que ses spasmes mimaient
― Il s’ébrouait comme un dieu sans tête
― C’était de nostalgie peut-être
― Son cœur dégorgeait plus d’une ombre
― Il n’avait pas encore de nom
― Le verbe en lui bandait comme une corde
― Il n’était pas poète encore
― Gravide montait l’écho du Rhymeur celte
― Les voix glissaient sur lui, fleuves de sel
― Son sexe répondait aux étoiles
― Mais dans un étrange patois !
― La nuit, il rêvait à rebours
― Des rêves d’or et de boue
― Dans son regard flambait un petit christ
― Sanglots des entrailles et cris !
― Aux rumeurs de l’aube il semblait sourd
― Ténèbre et clarté prenaient en lui leur source
Lettera 1
Bien-aimable cousine,
J’ignore s’il existe encore
des raisons de croire à la
gueuse réalité qui végète
dans notre ombre, à cette
voix emplumée qui jaillit
et se répand comme le trop-
plein de moi-même que vous
avez si gentiment transvasé
hier au soir pendant que nos
tantes jouaient au piquet,
mais je sais
qu’il n’y a plus d’écho sous
la langue, plus d’écho dans
nos corps traversés de syl-
labe en syllabe.
Tandis que m’emportaient
vos seins étarqués comme
des voiles, vos soubresauts
obsolètes de vierge au sang
bleu, j’ai rêvé d’un univers
plus âpre que les temples
intérieurs voués à des dieux
sans verbe et sans visage,
à des anges peut-être chus
des Tours du Désir mais
moins gluants et insidieux
que la parole
Quand elle glisse
Avec malice
Comme un réglisse
Comme une eau lisse
En vous complice
Mon Ophélys !
Ce sixain dont j’entends
siffler en vous les rimes
arabes ou persanes, je l’ai
composé en arpentant votre
syntaxe fragile et sans
doute monotone à en mou-
rir ― pardonnez cette gra-
cieuse obscénité ! ― mais
pourtant si récalcitrante
à l’éphémère. (Pour que
Grand’Ma, mon brave inqui-
siteur, ne me soumette à
la question, je m’empresse
de vous livrer ces bouts-rimés.
Si Tante les découvre, im-
putez-les à P. dans son
adolescence ou à l’album
d’Eudoxie. Amen !)
Foin donc,
tendre amie, de la réalité
mendiante à l’ombre de nos
corps, foin des mots éclatés
qui voudraient que cessent
de tourner nos destinées-
derviches.
… Il était une fois une voie
lactée qui rêvait d’être
source de vie et mère de
toute éternité, mais le cœur
ne dégorge aujourd’hui que
des étoiles familières et
il-n’y-a-plus-d’écho.
Reviendrez-vous au jardin
où nos cris mouraient dans
les feuilles ?
Je baise vos mains,
M. Lerma
P.S. Mes compliments aux
tantes
