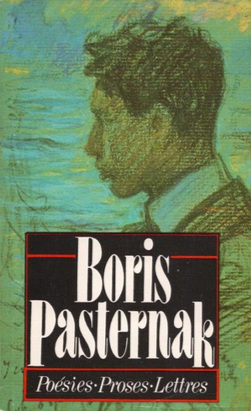
Boris PASTERNAK (1890-1960)
Poésies. Proses. Lettres
Préface de Evguéni Pasternak,
le fils du poète
• Choix de poésies
• Prose
• Le Trait d’Apelle (récit de 1915)
• Les Voies aériennes (récit de 1924)
• Sauf-conduit (récit autobiographique, 1930)
• Etudes sur Verlaine, Chopin, Shakespeare
• Hommes et situations (essai autobiographique (1956-57)
• Choix de lettres (1912-1960)
Le poète Andreï Voznessenski (1933-2010) a laissé des souvenirs sur Boris Pasternak.
Ils sont repris en introduction à l’anthologie poétique (voir l’onglet Traduire) du prix Nobel de littérature 1958.

Boris Pasternak tel qu’en mon souvenir
« Ils allaient, ils allaient toujours, et lorsque cessait le chant funèbre, on croyait entendre, continuant sur leur lancée, chanter les jambes, les chevaux et le souffle du vent… » Voici bientôt trente ans que, le jour de sa mort, les gens défilent devant sa tombe, comme s‘ils prolongeaient indéfiniment la phrase inaugurale du Docteur Jivago.
…L’averse tambourine sur les parapluies. Des centaines de personnes trempées se serrent entre les piquets entourant les tombes. Quelqu’un tient un parapluie au-dessus des orateurs. J’allume un cierge au pied du monument. Durant plus d’une heure on lit ses poèmes et, malgré le vent et la pluie, le petit bout de cierge héroïque continue de brûler en clignotant dans son chandelier vert. À travers le feuillage, à travers le brouillard du champ fatidique, j’aperçois sa datcha; à travers une distance presque trentenaire, j’aperçois la foule à l’enterrement du poète en disgrâce.
Les caméras scintillaient. Des écrivains renommés regardaient la multitude populaire en cachette, par les interstices des clôtures et des rideaux. C’était une époque maussade, dont il ressentit tous les déchirements.
Lecteur, tu as sous les yeux un recueil qui sort de l’ordinaire. Il a été confectionné « en famille ». Les notes sont rédigées par le connaisseur de son œuvre le plus digne de foi : Evguéni Borissovitch Pasternak, fils du poète et de sa première épouse, le peintre Evguénia Lourié.
Malgré tout son esprit de révolte, Pasternak avait une discipline intérieure, une vie organisée ; à l’instar de la musique qui, en dépit de son caractère spontané et imprévisible – ou peut-être pour cette raison même –, connaît les césures et les syncopes, les quartes et les quintes. Ses heures de travail, de repas et de repos, étaient intangibles. Les habitants de Pérédelkino pouvaient, comme sur le soleil, régler leurs montres sur sa promenade du soir. C°était un homme aux solides assises. Le devoir, la maison, la famille étaient bien ancrés en lui.
À vous ma gratitude, à vous mes baisers, mains
De la patrie, de l’amitié, de la famille.
Pasternak avait intitulé Ma sœur la vie le livre le plus « sien », écrit pendant l’été révolutionnaire de 1917, « quand les arbres tenaient des meetings ». Le poète abordait la vie comme une sœur, hors de la passion sensuelle, dans le droit fil de la thèse classique de Pouchkine: « Et la nature indifférente… » À l’époque où il s’écarta de l’avant-gardisme pour adopter une manière « classique », il aurait voulu, me disait-il, récrire dans un style plus serein les vers romantiquement audacieux de Ma sœur la vie (il se rappelait toutes les prémisses de ses poèmes). Je me réjouis qu’il n’y ait pas réussi…
Sa technique poétique était née de l`étude de la musique dans sa jeunesse, de l’admiration pour Scriabine, de la technique même du piano. Chaque vers, chaque mot « travaille » comme une note, comme les touches; nul vers inactif et vide chez lui, chacun est tendu à l’extrême.
Ou kápel tiájest záponok
(gOUttes lOUrdes comme bOUtons de manchette)
Entendez-vous les doigts frapper les touches une à une? Et en même temps résonne une image visuelle, l’éclat argenté et argentin des gouttes de pluie. Cette musique en laisse transparaître une autre – née de l’esprit, transcendantale – que les poètes ont perçue à travers l’élément chrétien. Mais ce qui transparaît surtout, c’est la musique de la conscience. Il y a de nos jours une pénurie de conscience dans le monde ; un problème universel qui touche jusqu’aux meilleurs des fils de l’humanité. Enrico Fermi avait dit après l’essai de la première bombe atomique à Alamgordo: « Ne n’embêtez pas avec vos déchirements de conscience. Après tout, c’est une physique admirable !»
C’est chez Pasternak que, tout jeune encore, j’entendis le roman et les poèmes de sa propre bouche. Les lectures avaient lieu au premier étage, dans son bureau lanternon en demi-cercle. On apportait les chaises d’en bas. Il y avait d’ordinaire une vingtaine d’invités. Pasternak s’installait à la table. Il portait une veste légère et argentée, une vareuse dans le genre de celles qui sont aujourd’hui à la mode. Une fois, il lut « Nuit blanche », « Le rossignol », « Conte », tout le cahier de cette période. Avec Hamlet à la fin. Il récitait, le regard fixé au-dessus de nos têtes sur quelque chose que lui seul pouvait voir. Son visage s’allongeait, s’émaciait. Et sa veste était comme un reflet de la nuit blanche. Cela durait habituellement près de deux heures. Parfois, lorsqu’il souhaitait expliquer quelque chose à ses auditeurs, il se tournait vers moi, comme si l’explication m’était destinée: « Andrioucha, dans Conte j’ai essayé de frapper l’emblème du sentiment comme sur une médaille : le guerrier sauveur en selle sur un cheval avec la belle ». C’était notre jeu à nous deux. Je savais par cœur ces vers où il porte à son comble son procédé de désignation d’une action, d’un objet, d’un état. On entendait résonner les sabots :
…Closes les paupières.
Les nues. Et le ciel.
Les gués. Les rivières.
Les ans et les siècles.
Il ménageait ainsi l’amour-propre des autres. Puis il demandait à la cantonade quels poèmes avaient plu davantage. La plupart répondaient : « Tous ». Cette réponse évasive le décevait. Alors on détachait « Nuit blanche ». L’acteur Livanov désignait Hamlet. Le rôle d’Hamlet qu’il n’avait jamais eu l’occasion de jouer était sa tragédie, et il étouffait sa douleur sous les grimaces et les bravades d’un bouffon.
Tout s’est tu. Je suis entré sur scène.
Adossé à un pan du décor…
Livanov se mouchait. Les cernes gonflés se marquaient encore plus sous ses yeux. Mais l’instant d’après, il était déjà en train de rire parce qu’on invitait tout le monde à passer à table, en bas. On descendait. On se trouvait encerclé, au milieu du feu d’artifice bleuâtre des modèles vaporeux peints par son père, Léonide Pasternak, peut-être le seul impressionniste russe.
Ô, ces agapes de Pérédelkino ! Il manquait des chaises. On apportait des tabourets. Pasternak officiait avec l’enivrement du rituel géorgien. C’était un hôte chaleureux. Il couvrait de confusion ses invités en tendant lui-même à chacun son manteau. J’en fus ahuri la première fois. Saisi d’une sainte panique, j’essayais de lui arracher mon manteau.
J’étais pour lui quelqu’un « de la rue ». Je me souviens de ce matin de décembre 1946.
«Pasternak te demande au téléphone! »
Mes parents me regardaient avec stupeur. Élève de quatrième, je lui avais envoyé mes vers et une lettre sans rien dire à personne. Ce fut le premier acte résolu qui devait décider de mon existence. Et voici qu’il répondait et m’invitait chez lui à deux heures, le dimanche suivant.
J’arrivai bien sûr une heure plus tôt à la maison grise de la rue Lavrouchinski. J’attendis, puis montai en ascenseur jusqu’au sombre palier du sixième. Il était deux heures moins une. On avait sans doute entendu claquer la porte de l’ascenseur. On ouvrit.
Il était debout dans la porte.
J’eus le vertige. La flamme oblongue et basanée de son visage me regardait avec étonnement. Un pull de stéarine fondue moulait sa robuste silhouette. Un courant d’air remuait sa frange. Ce n’est pas fortuitement que, plus tard, il choisira une bougie allumée pour son autoportrait.
Une main forte et sèche de pianiste.
Je fus frappé par l’ascétisme, l’espace pauvre et dénudé de son cabinet sans chauffage. Une photo carrée de Maïakovski et un poignard au mur. Le dictionnaire anglo-russe de Müller : Pasternak était alors rivé à des traductions. Sur la table, mon cahier recroquevillé, sans doute préparé pour notre conversation. Une vague de terreur et d’adoration déferla sur moi. Mais trop tard pour m’enfuir.
Il commença à parler sans préambule.
Ses pommettes frémissaient comme le triangle d’ailes bien serrées et prêtes à l’envol. Je le divinisais. Il y avait en lui une attraction, une force et une céleste inaptitude à s’adapter. Quand il parlait, son menton s’étirait vers le haut comme pour échapper au col et au corps. Peu après, tout m’était simple avec lui. Je le dévisageais à la dérobée. Son nez se busquait aussitôt après le petit creux à la racine, puis continuait bien droit, évoquant la crosse brune d’un fusil miniature. Des lèvres de sphinx. Des cheveux grisonnants et coupés court. Mais surtout ce magnétisme aux ondes fumeuses, flottantes…
Tout s’est décidé pour moi ce jour-là, ma vie a pris un sens et une destination magiques : ses nouveaux poèmes, les conversations au téléphone, celles du dimanche chez lui entre deux et quatre, nos promenades : années de bonheur et d’amour enfantin. Pouvais-je imaginer qu’il me serait donné un jour d’écrire une préface à son recueil de poèmes ?
Pour quelle raison m’avait-il répondu?
Il était seul en ces années-là, fatigué des brimades; il avait soif de sincérité, de pureté dans les rapports avec autrui, et ne voulait plus tourner en rond. Néanmoins, ce n’était pas tout. Peut-être ces étranges relations avec un adolescent, un écolier, cette quasi-amitié éclairent-elles quelque chose en lui ? Il ne s’agissait pas même de l’amitié entre un lion et un petit chien, ou plutôt un chiot. Peut-être ce qu’il aimait en moi, était-ce lui-même, l’écolier qui accourut jadis chez Scriabine ?
Il était attiré par l’enfance. L’appel de l’enfance ne s’était jamais tu en lui.
Il n’aimait pas qu’on lui téléphone, aussi appelait-il lui-même. Parfois à plusieurs reprises dans la semaine. Puis il y avait de pénibles trêves. Il parlait d’une seule haleine, sans prendre le temps de se retourner. Puis il s’interrompait brusquement, en pleine course. Il ne se plaignait jamais, quelles que fussent les nuées qui l’assombrissaient. « L’artiste, disait-il, est par nature optimiste. L’essence de la créativité est optimiste. Même si tu écris des choses tragiques, tu dois écrire avec vigueur; or, ni l’abattement, ni la mollesse ne donnent des œuvres fortes. » Sa parole s’écoulait en monologue saccadé, ininterrompu. Avec plus de musique que de grammaire. Elle ne se découpait pas en phrases, ni les phrases en mots, mais tout s’écoulait en flux inconscient de la conscience, la pensée était marmottée, revenait sur elle-même, ensorcelait. Semblable était le flux de sa poésie.
Pasternak est un adolescent.
Certains artistes se distinguent par un âge invariable. Ainsi, Bounine et Nabokov ont la netteté de l’automne précoce, ils semblent avoir toujours eu quarante ans. Pasternak, lui, est l’adolescent éternel, indocile. Dans ses vers il n’a mentionné qu’une fois son âge: « J’ai quatorze ans ». Une fois pour toutes.
Parmi des étrangers, dans la foule, il était timide à s’en aveugler, et il fallait le voir courber la nuque, tendu tel un taureau. Il m’emmena un jour au théâtre Vakhtangov, à la première de Roméo et Juliette joué dans sa traduction. J’étais assis à sa droite. Mon épaule gauche, ma joue, mon oreille étaient comme engourdies par cette proximité, comme anesthésiées. Je regardais la scène mais c’était quand même lui que je voyais, son profil phosphorescent, sa frange. De temps en temps il marmonnait le texte à la suite des acteurs.
Pourquoi les poètes meurent-ils?
Pourquoi la Première guerre mondiale fut-elle déclenchée? Quelqu’un avait trucidé un archiduc? Mais si on l’avait raté, s’il avait fait la grasse matinée ce jour-là ? La guerre n’aurait pas eu lieu ? Hélas, il n’y a pas de hasards; rien que le Temps et l’Histoire. « Les génies meurent au moment voulu », disait son maître Scriabine, qui mourut après s’être gratté un bouton sur la lèvre.
Staline avait dit de Pasternak. « Ne touchez pas à cet innocent ! »
Le poète me parlait de Staline: « Je me suis adressé à lui plus d’une fois et il a toujours accédé à mes demandes ». il s’agissait probablement d’aide à des victimes de la répression. Pasternak faisait partie du petit nombre de gens qui ne craignaient pas d’envoyer des lettres et des colis aux détenus. À ses yeux, Staline était un monstre, mais un « géant de l’ère préchrétienne ».
Je me souviens d’un Nouvel An chez lui, rue Lavrouchinski. Pasternak rayonnait au milieu de ses invités. Il était à la fois le sapin et l’enfant. Les sourcils de Neuhaus remuaient comme un triangle d’aiguilles de sapin. Evgueni, le fils aîné du poète, avait gardé sa prestance d’officier et paraissait sorti, comme d’un miroir, du portrait au mur, peint par sa mère. L’appartement avait une issue sur le toit, sur les étoiles. On pouvait s’attendre à tout, même au pire : le poignard mural n’était pas seulement un ornement, il pouvait aussi servir à se défendre.
Ses poèmes conservaient le mystère vertigineux, profond et prophétique, des fêtes, le feu d’artifice des préludes de Scriabine. Il n’admettait pas les anniversaires, les tenant pour des dates de deuil. Il interdisait de lui adresser des voeux. Je m’ingéniais cependant à lui offrir des fleurs la veille ou le lendemain, le 9 ou le 11, pour ne pas enfreindre la lettre de l’interdit. Je voulais lui apporter un peu de réconfort. Je venais avec des cyclamens blancs et écarlates, parfois avec des grappes mauves de jacinthes qui tremblaient comme des coupes de cristal taillé en petites croix. Quand j’étais étudiant en architecture, je pouvais lui apporter un arbuste de lilas dans un pot. Il adorait ces fleurs et me pardonnait volontiers ma ruse annuelle.
Lorsqu’il se fut installé à Pérédelkino, les champs côtoyaient ses promenades. Aux heures de poésie et de méditation, vêtu comme un ouvrier du coin ou comme un garde-voie, avec une casquette grise, une gabardine caoutchoutée bleu foncé aux petits carreaux noirs et blancs sur le revers, ainsi qu’on en portait à l’époque, et le pantalon rentré dans les bottes quand il y avait de la gadoue, il passait le portillon et tournait à gauche, le long du champ, pour aller en bas vers la source et parfois même sur l’autre berge. Les ondes sensuelles du ruisseau, des saules argentés, les pensées de la forêt donnaient le ton aux vers. De l’autre côté du champ, trois pins sur une petite butte observaient l”aisance de son pas. À travers les branches de l’allée, la petite église peinte flamboyait comme un pain d”épice. On aurait dit un jouet doré suspendu à la branche d’un sapin de Noël. La résidence d’été du patriarche se trouvait là-bas, et il arrivait que la préposée, confondant «Patriarche » et « Pasternak » sur l’enveloppe, apporte chez le poète des lettres adressées au dignitaire ecclésiastique. Cela amusait Pasternak, qui rayonnait alors comme un gosse.
Peu de poètes en Russie ont échappé à l’influence de Pasternak. Il n’était pas jusqu’à ses persécuteurs et détracteurs qui n’écrivissent souvent « à sa manière› ». Pas seulement chez nous, d’ailleurs. Le sarcastique Nabokov, qui lançait des piques à l’auteur de Jivago, n’avait pas pu résister à son influence, dans la poésie comme dans la prose. Vous rappelez-vous, dans la Défense Loujine, l’admirable agitation sur la terrasse au clair de lune ? Le joueur d’échecs russe contemple l’astre nocturne dans une petite ville d’Allemagne. La lune et les ombres se transforment en échiquier sur le sol de la terrasse : «Et une faible pression sur l’œil suffisait à faire sauter une étrange lumière noire, à la faire sauter pareille à son cavalier noir qui prenait sans coup férir le pion… » Il fait descendre de ses genoux la femme qu’il aime pour mieux admirer cette magique partie d’échecs jouée par la lune. Comment ne pas se souvenir ici d’un autre Russe dans la ville allemande de Marbourg, du jeu d’échecs de sa passion dans le poème « Marbourg » de Ma sœur la vie ?
On l’enterra le 2 juin.
Je n`ai pas oublié la sensation de vide terrible qui s’empara de moi dans sa datcha pleine à craquer. Richter venait de finir de jouer. Tout tournait devant moi. La vie avait perdu son sens. On le porta sur les épaules, renonçant au corbillard, on le porta depuis la maison qui avait abrité sa vie, on contourna le champ qu°il aimait pour aller vers la butte aux trois pins que lui-même avait contemplée naguère.
Le chemin montait. Le vent soufflait. Sur le fond de ce jour intolérablement bleu et des nuages blancs, se gravait son profil tendu de bronze, déjà étranger et maigri. Le chemin inégal le faisait légèrement tressaillir. L’inutile fourgon se traînait devant lui que portait une foule affligée : non pas des hommes de lettres, mais des gens venus d’ailleurs et des habitants de l’endroit, les témoins de ses jours, des étudiants éplorés, les héroïnes de ses poèmes. Chez Evguéni, son fils aîné, se révélaient désespérément les traits du défunt. Les appareils photos cliquetaient. Les arbres passaient par-dessus les clôtures, le chemin de terre qu’il avait suivi tant de fois pour aller à la gare était triste et poussiéreux.
Quelqu’un marcha sur une pivoine au bord de la route.
Je ne revins pas à la datcha. Il n’y était pas. ll n’était plus nulle part.
J’ai écrit cette nuit-là le poème « Cimes et racines ». Malgré l’atmosphère antipasternakienne qui régnait alors, je pus le publier dans le journal Litératoura i jizn (La Littérature et la vie) en y ajoutant ce sous-titre « À la mémoire de Léon Tolstoï ». Après tout, ce n’était pas trop exagéré car le cheminement spirituel de ces deux écrivains n’est pas sans affinités.
lls n’allaient pas l’enterrer,
Ils allaient le couronner…
Je me souviens qu’un jour je l’attendais sur l’autre berge de l’étang de Pérédelkino, près de la longue passerelle de planches qu’il lui fallait franchir. D’habitude, il passait là aux environs de six heures. C’était un automne doré. Le soleil descendait et, de derrière la forêt, éclairait d’un oblique rayon l’étang, la passerelle et le bord même de l’eau. La cime d’un aune cachait l’extrémité de l’étang. Il surgit au tournant et s’approcha, non pas en marchant mais comme s’il planait au-dessus de l’étang. Je ne compris qu’ensuite de quoi il retournait. Le poète était vêtu de sa gabardine bleu foncé, dessous laquelle apparaissaient un pantalon de calicot couleur paille et des chaussures de toile claire. Les planches récemment rabotées étaient de la même couleur et du même ton. Les pieds du poète, son pas se fondaient à la teinte de la passerelle. On ne discernait pas leur mouvement. La silhouette en gabardine se rapprochait en planant au-dessus de l’onde. Pasolini qui a filmé la marche sur les eaux dans l’Evangile selon saint Matthieu aurait certainement envié cette scène. Un sourire enfantin de perplexité ravie errait sur le visage de Pasternak.
Laissons-le dans ce flot doré de la lumière d’automne.
A. Voznessenski, 1988
i Le Docteur Jivago. Gallimard, 1958.
ii Pérédelkino, dans les environs de Moscou, abrite nombre de datchas (résidences secondaires) d’écrivains.
iii Le mot russe « iourodivy », employé par Staline au sujet de Pasternak, désignait autrefois l’innocent, le « fol-en-Christ » qui avait renoncé à tous les biens terrestres et proférait sur la place publique des discours sibyllins. Faisant l’objet d’une vénération au sein du peuple, il était aussi théoriquement « intouchable » pour les puissants de ce monde.
