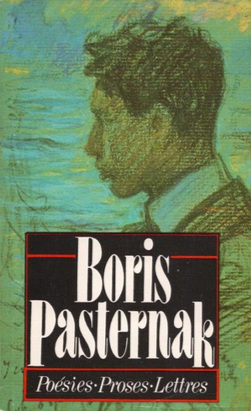
BORIS PASTERNAK
POÉSIES. PROSES. LETTRES
Préfacé par le fils du poète
Éditions Librairie du Globe

Fils d’un peintre réputé et d’une pianiste de talent, il fut plongé dès l’enfance dans l’univers de la musique et de la peinture. Rachmaninov, Scriabine et d’autres rendaient souvent visite aux Pasternak. Par la suite, l’engouement pour la musique céda la place à la philosophie, puis à la poésie, mais celle-ci sera envoûtée à jamais par les sons et les couleurs, tout en restant encline à un rapport philosophique au monde. Elle se caractérise par des associations et des images inattendues qui ont pourtant l’éclat de l’évidence. La nouveauté verbale s’y marie à une écriture que l’on pourrait qualifier d’impressionniste. Ajoutons que Pasternak fut un remarquable traducteur de Verlaine et des poètes géorgiens, du Faust de Goethe et des tragédies de Shakespeare.
Boris Pasternak, aujourd’hui encore, reste surtout connu dans le monde pour son roman Le Docteur Jivago qui lui valut le prix Nobel de littérature en 1958, mais il est avant tout un des quatre ou cinq poètes russes majeurs du vingtième siècle. Le choix des poèmes a été établi par Evguéni Pasternak, le fils du poète. En préface, on pourra lire les souvenirs du poète Andreï Voznessenki qui, tout jeune encore, rendit souvent visite à Pasternak et reçut sa « bénédiction ».
Février
Février. De l’encre et des larmes!
Dire à grands sanglots février
Tant que la boue et le vacarme
En printemps noir viennent flamber.
Prendre un fiacre. Et pour quelques sous
Passant carillons et rumeurs,
Aller où l’averse à tout coup
Éteint le bruit d’encre et de pleurs.
Où, tels des poires qu’on calcine,
S’abattent des milliers de freux
Dans les flaques, jetant un spleen
Stérile et sec au fond des yeux.
Le vent est labouré de cris,
La neige fond en noirs îlots ;
Et plus les vers seront fortuits,
Mieux ils naîtront à grands sanglots.
1912
Les leçons d’anglais
Quand vint à chanter Desdémone
(Il lui restait si peu à vivre),
Non pas à l’astre d’amour morne –
Au saule allaient ses sanglots ivres.
Quand vint à chanter Desdémone
(Voix s’enflant pour reprendre espoir),
Un noir démon gardait le psaume
Des flots en pleurs – pour ses jours noirs.
Quand vint à chanter Ophélie
(Il lui restait si peu à vivre),
Le sec de l’âme s’est enfui
Comme un foin que les vents poursuivent.
Quand vint à chanter Ophélie
(Nausée des rêves qui l’empoigne),
Dans l’eau quels trophées l’ont suivie ?
Rameaux de saule et chélidoines.
Leur corps aimant, laissée à terre
La passion-loque, entrait dans l’onde
Du grand bassin de l’univers
Pour s’étourdir au bruit des mondes.
Eté 1917
Définition de la poésie
C’est un sifflement qui s’enfle vite,
C’est un bruit de glaçons écrasés,
C’est la nuit où la feuille palpite,
C’est deux rossignols au fer croisé.
C’est le pois qu’assourdit le tumulte,
C’est l’univers pleurant dans ses cosses,
C’est Figaro s’abattant des flûtes,
En grêlons, sur les plants, les écorces.
Tout ce que la nuit voudrait trouver
Au fond des baignades, dans les antres,
L’étoile qu’elle porte au vivier
Dans ses paumes mouillées, frémissantes.
Plus que planches dans l’eau, on suffoque,
Le ciel est enfoui sous une vergne…
Les étoiles en riraient bien fort,
Mais quel trou perdu que l’univers!
1917
***
Il n’y aura plus personne,
Que l’ombre du soir. L’hiver
Qui au regard s’abandonne
Par les rideaux entrouverts.
Rien que les flocons blafards
Qu’un vol fugitif consomme;
Les toits, la neige, et à part
La neige et les toits – personne.
Et les ramages du givre,
Les soucis d’hivers passés,
Avec le spleen vont revivre,
Reprendre en moi leur tracé.
Et la faute sans pardon
Me poindra, et, par disette
De bois, à nouveau grimperont
Les rondins à mi-fenêtre.
Mais dans l’entrée sans défense
Frissonnera la tenture;
Et arpentant le silence
Tu viendras, tel le futur.
Tu seras toute en blanc, pauvre
D’ornements hors de saison,
Toute en ces mêmes étoffes
Où l’on taille les flocons.
1931
Ecoutez ce poème chanté en russe
Hamlet
Tout s’est tu. Je suis entré sur scène.
Adossé à un pan du décor,
J ‘entends l’écho d’une voix lointaine
Égrener ce qui sera mon sort.
La nuit sur moi a braqué les yeux
D’un millier de jumelles complices.
Abba, Père, fais si tu le peux
Que s’éloigne de moi ce calice.
J ‘aime ton dessein têtu, pourtant,
Et ce rôle, j’y mettrais de l’âme.
Mais pour cette fois dispense-m’en,
Car ici se joue un autre drame.
Mais on a fixé l’ordre des scènes
Et fatale est l’issue du chemin.
Seul. Tout fond dans la nuit pharisienne.
La vie à vivre, ce n’est pas rien.
1946
Les 2 derniers vers de la seconde strophe sont littéralement repris des Evangiles
(Luc 22,42 ; Matthieu 26,39 ; Marc 14,36) : « Abba, Père, si tu le veux (si c’est possible), éloigne de moi ce calice (cette coupe) ».
Août
Ce matin, au rendez-vous fidèle,
En oblique traînée de safran
Est venu se glisser le soleil
Depuis le rideau jusqu’au divan.
Chaudement d’ocre il a recouvert
La forêt, le bourg ensommeillé,
Le pan de mur près de l’étagère,
Mon lit avec l’humide oreiller.
Et je me suis souvenu des larmes
Qui Pavaient mouillé légèrement.
Je rêvais que dans la forêt calme
Vous alliez à mon enterrement.
Vous marchiez à l’écart ou en file,
Et quelqu’un s’est rappelé, surpris,
Que l’on est le six août, ancien style,
Transfiguration de Jésus-Christ.
Ce jour-là, au sommet du Thabor,
Apparaît une lueur sans feu,
Et l’automne, en oriflamme d’or,
Attire et enchaîne tous les yeux.
Et par l’aulnaie pauvre et nue qui tremble
Vous alliez vers les tombes, les croix,
Là où la forêt rouge-gingembre
Ainsi qu”un pain d”épice flamboie.
Le ciel côtoyait, si vaste et grave,
La cime des arbres soudain quiets,
Et par la voix des coqs, sans entraves,
Les lointains longuement se hélaient.
La mort, arpenteuse communale,
Au cimetière attendait la fin
Et, voulant creuser tombe à ma taille,
Déchiffrait mon visage défunt.
Une voix bien tangible dans l’air
Résonnait près de tous, calmement;
Ma voix prophétique de naguère
S’élevait, échappée au néant:
« Adieu l’azur de ce jour céleste,
Et l’or de la Transfiguration.
Adoucis d’une ultime caresse
L’amer instant de séparation.
Adieu, années troubles, années sombres.
Quittons-nous ici, femme défiant
Le gouffre d’humiliations sans nombre!
De tes batailles je suis le champ.
Adieu l’essor d’ailes grand ouvertes,
Le libre vol forçant les obstacles,
L’univers révélé dans le Verbe,
Adieu l’œuvre, et le don des miracles ! »
1953 (Poème de Jivago)
