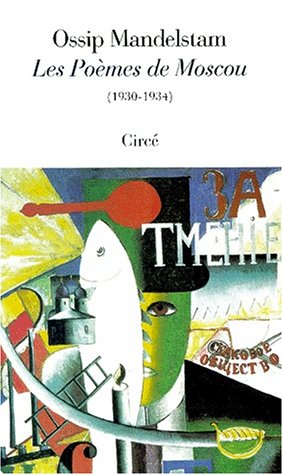
Ossip Mandelstam
Les Poèmes de Moscou (1930-34)
L’œuvre d’Ossip Mandelstam (1891-1938), marquée par une recherche existentielle où le rapport du poète au monde ne cessa d’évoluer parallèlement à la transformation du matériau poétique, de ses principes d’organisation, se divise nettement en deux périodes, en deux parties à peu près égales en nombre : 1908-1925 et 1930-1937.
Venant après un long silence de cinq ans, qui consommait la rupture avec la littérature “ autorisée ”, avec la littérature tout court, les Poèmes de Moscou incarnent un rare moment d’équilibre du “ moi ” et de la forme intérieure, d’ancrage polyphonique dans la substance même de la cité et de l’époque stalinienne. Paradoxalement, Mandelstam y accède à une liberté et une harmonie sans exemple dans la poésie russe du vingtième siècle. Structuré en plusieurs cycles — Arménie, le Loup, Moscou la bouddhique, les poésies russe et italienne, Huitains philosophiques, Requiem —, le livre s’achève au début de 1934 sur deux poèmes d’amour qu’illumine la destinée tragique du poète.
Peu de temps auparavant, il avait écrit et lu à quelques personnes une féroce épigramme contre Staline, qui provoquera son arrestation en mai 1934. Au lieu de la mort attendue, ce furent trois années d’exil à Voronej. Arrêté une deuxième fois en mai 1938, Mandelstam disparaîtra bientôt dans un camp près de Vladivostok, sur la rive du Pacifique.
Publiés pour la première fois en version intégrale et bilingue, tout comme les Cahiers de Voronej déjà parus aux éditions Circé, les Poèmes de Moscou devaient être réunis à ces derniers sous le titre commun et significatif de Poésies Nouvelles.
Allons à la cuisine un moment.
Douce l’odeur du pétrole blanc.
Une miche de pain, un couteau…
Actionne, si tu veux, le réchaud,
Ou cherche de la ficelle, assez
Pour attacher notre vieux panier,
Et nous irons dès l’aube à la gare,
Où nul ne peut nous trouver, nous voir.
Janvier 1931
Le cocher
Dans un col tout près des crêtes,
Sur le versant musulman,
La mort était de la fête —
Comme un rêve terrifiant.
Notre cocher, tout semblable
À un raisin sec trop cuit,
Aurait pu servir le diable,
Taciturne comme lui.
Son guttural de l’arabe
Et ce cri absurde « Tso ! »
Il nous cachait son visage :
Une rose ou un crapaud.
Et gardant ainsi la tête
Sous un masque en cuir tanné,
Il pressait, pressait les bêtes
D’une voix rauque et damnée.
Et de poussées en secousses,
Sans cesse collés au mont,
Tournoyaient dans cette course
Auberges et phaétons…
Soudain j’ai crié : arrête !
Par le diable, c’est bien lui —
Le président de la Peste
Egaré dans ce pays !
Il conduit depuis son siège
Une litanie sans nez,
Pour que tourne, gai manège,
Notre terre aigre et sucrée…
Là, dans le Haut-Karabakh,
À Choucha, fauve cité,
J’ai connu cette peur âpre
Qui à l’âme est chevillée.
De tous côtés, les yeux morts
De quarante mille maisons ;
Sur les versants gît encore
Le travail, vide cocon.
Les murs dénudés rosissent
Sans honte et, au-dessus d’eux,
Dans une brume s’enlisent
Le ciel et sa peste bleue.
12 juin 1931
(Dans ce poème, apparaissent les stigmates terribles du génocide arménien, 15 ans après. « Ce fut notre dernière sortie d’Erivan, la fin de notre voyage en Arménie. Choucha commençait par un cimetière interminable… Nous avions déjà vu des villages abandonnés par l’habitant, où il ne restait plus que quelques maisons détruites, mais dans cette ville qui, apparemment, avait été riche autrefois, la catastrophe, le massacre étaient tangibles jusqu’à l’horreur. Partout le même tableau : deux rangées de maisons sans toit, sans portes ni fenêtres. Les murs étaient en tuf rose, toutes les cloisons avaient été défoncées, on apercevait le ciel bleu à travers ces carcasses. On disait qu’après le massacre tous les puits débordaient de cadavres (…) C’est en allant à Stépanakert, chef-lieu de la région du Haut-Karabakh, que nous étions tombés sur cet unique cocher, « sans nez » parce qu’une grande pièce de cuir dissimulait une bonne partie de son visage. » Souvenirs de Nadejda Mandelstam).
Impressionnisme
Ce qu’il nous a peint tout d’abord,
C’est la syncope des lilas,
Et comme des squames il posa
Les couleurs aux degrés sonores.
De l’huile il comprit l’épaisseur :
Son été croûteux se réchauffe
Avec de la cervelle mauve
Et s’élargit dans la touffeur.
Et l’ombre, toujours plus violette !
Sifflet ou fouet : un feu languit.
Des pigeons gras, aurait-on dit,
Qu’au four les cuisiniers apprêtent.
On devine une balançoire,
Des voilages peints à moitié,
Et dans la ruine ensoleillée
Un bourdon s’affaire au hasard.
23 mai 1932
***
<épigramme contre Staline>
Nous vivons sans sentir sous nos pieds le pays,
À dix pas nos paroles se sont évanouies,
Et si quelques mots quand même se forment,
C’est le montagnard du Kremlin qu’ils nomment.
Ses doigts, comme des vers, sont très gras et épais,
Et ses mots de cent pouds ne vous ratent jamais,
Ses moustaches de cafard semblent rire,
Et brillent ses bottes de tout leur cuir.
Autour de lui, un tas de chefs minces de cou,
Les sous-hommes zélés dont il joue et se joue.
Tel siffle, tel miaule, geint ou ronchonne,
Lui seul frappe du poing, tutoie et tonne,
En forgeant, tels des fers à cheval, ses décrets —
En plein front et dans l’œil, au ventre, où ça lui plaît !
Toute mise à mort lui est une fête,
Et de bomber sa poitrine d’Ossète.
Novembre 1933
***
Sous le fouet rougiront tes épaules si frêles,
Tes épaules si frêles brûleront dans le gel.
Tes mains fines auront des fers à soulever,
Des fers à soulever, des cordes à tresser.
Sur le verre iront nus tes tendres pieds d’enfant,
Tes tendres pieds d’enfant sur le sable sanglant…
Et, cierge noir, pour toi il me faudra brûler,
Il me faudra brûler mais sans pouvoir prier.
(Février) 1934

