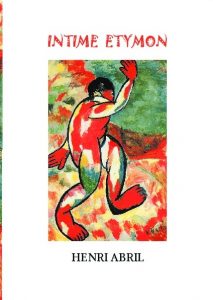
INTIME ETYMON
Aphorimes / Nomen Omen
Editions des Aonides, 2018
134 pages
Prix : 9 Euros
Puisque l’aphorisme, suggère Milan Kundera, peut être perçu comme une forme poétique de la définition, il s’agira ici d’un sous-genre ou plutôt d’un surgeon de cette forme même. L’omission du « s » n’est donc pas une coquille, ni la substitution oulipienne dite aussi locurime. Le vocable est appelé à faire écho à la tradition des proverbes et sentences rimés, des conjurations kamtchadales, mais également au métabolisme associatif de Jean-Pierre Brisset, aux contrepoèteries de Rrose Sélavy et à certaines gloses de Michel Leiris.
Oubli et mémoire de lui-même, le mot se dépose, se recompose pour remonter à sa source, à ses racines, tout en se ramifiant et bourgeonnant en quête d’une mutation possible ou improbable, ce qui vaut en premier lieu pour le nom du poète. Nomen omen : sans doute n’ont-ils pas tort ceux qui, depuis l’Antiquité platonicienne, ont entrevu dans le nom un condensé du destin. À la fois baptême, bilan et anticipation, car ce n’est qu’avec la mort que s’ouvre la cage du nom – pour le laisser s’envoler dans une sorte de danse rituelle ou virtuelle, à la façon de la nostalgie radieuse suivant l’orgasme
« L’aphorisme, ce sont des points qu’aucune ligne ne relie », note le poéticien russe Mikhaïl Gasparov en citant je ne sais plus qui. Dans le cas de l’aphorime, c’est la rime papillonnante qui cherche à relier les points. Rrose, certes, nous avait prévenus : jeux de mots, jets mous. Mais on sait aussi que les jeux de mots sont aptes à traduire, peut-être même à adoucir ou guérir certains maux du je – doublets d’amour et de haine, gènes constellés des Gémeaux –, parce que, justement, ils mettent en question et remettent en jeu ce qui fonde l’homme même : le verbe fait chair. Telle est la principale raison d’être de cette Volksetymologie portative et intime. Aphorimes, les rimes de mes affres.
Ce livre est dédié à Fernando Arrabal
***
Article de René NOËL, sur Poezibao
La purgation des diètes
Le poète découcheur « Plutôt que de chanter sur la lyre d’or, il faisait son lit dehors » (p. 57) : Henri Abril avec le Baigneur de Kasimir Malevitch pour talisman distribuant courbes et couleurs en couverture, nous envoie ses inflexions et pesées, les nouvelles de (la) sa poésie vue depuis la barque du fragment incisif prenant la vitesse à son jeu, tantôt lenteur du sens délié, dénouant les stases – l’est trop souvent lait figé, tourné -, tantôt rayons de paronymes, de rimes internes et externes lexicales et mentales provoquant des avalanches, des raccourcis et des distributions nouvelles de l’histoire-temps, des voisinages inédits entre faits et personnes, créateurs et entités vivantes du monde extérieur à l’homme avec pour viatique l’abrégé onomastique de quatre-vingt poètes de tous les temps.
Aux anathèmes, aux thèmes (de vithèmes et morthèmes nourri, le lecteur bientôt enhardi devient Bernard-l’Hermite et assiste alors à la convection, La règle de Porchia « Regarde bien les yeux grands ouverts, puis ferme-les pour mieux voir à l’envers. » (p. 84), se voudrait lui aussi dénoueur de fils de convictions du poète-yéti qui tranche la question de l’invisible et des pas, trace, à l’exemple de Varlam Chalamov, une voie inaugurale dans la prose désarçonnant au besoin les empreintes convenues, Henri Abril corps vif prend ici les voies transversales de l’aphorisme – aphorimes, voies des dehors du bel, beau et vrai sublimes, soit les à-côtés, nervures microniennes des feuilles d’arbre, le vert pâle, espace neuf – sans lesquelles aucune métamorphose n’a lieu – élimés, troués d’avoir tant servi, Henri Abril substitue la vie infime, les accidents et les quantums des substances sous le signe d’Ovide et Martial, de leurs ironies envers leurs semblables et eux-mêmes que le poète ajuste au siècle neuf.
A l’heure où tout finit avant même d’avoir commencé, le mot et ses syllabes, ses lettres affranchies, exonérées du servage créent au plus près de soi et de l’infini, articulent l’indéterminé et l’histoire. Rimes, mires, grimoires de l’invisible au cœur des pigments de chaque lettre magique androgyne, évidence et énigme liées indéfectiblement en chaque signe de nos abécédaires où les noms propres et les noms communs sonnent et dissonent, partagent les étymologies aussi mystérieusement que manifestement, les tons intérieurs et les tailles des pensées envers les uns ou les autres ajustés en nous, Sans confession, sans concession : « Ce qui déroute en toi, Durutti, c’est un rite qui dure et dure, bien que jeté aux orties » (p. 41). Le poète devient rime et moire de lui-même inscrit dans l’histoire, la storia d’Elsa Morante. Fidèle à son insu à ses poèmes dont il sait, à l’instant où les lettres, le noir et le blanc de chaque mot surgissent de sa main sur la page, qu’à l’égal des songes exclus, ils rythment et prolongent les créations de ses devanciers.
Guennadi Gor que Henri Abril a traduit, n’aurait-il pas souscrit à cet ajustement des fils de l’histoire où autant le tragique que le comique d’inconséquence de nos vies deviennent clairs et transparents ? Lui qui sous le siège de Léningrad vit et écrit des scènes de cannibalisme, hôte et ami d’âme des obérioutes prenant eux-mêmes le témoin de la verbocréation des mains de Vélimir Khlebnikov, n’a-t-il pas éprouvé combien la poésie et l’homme coïncident, » à la fois baptême, bilan et anticipation, car ce n’est qu’avec la mort que s’ouvre la cage du nom – pour le laisser s’envoler dans une sorte de danse rituelle, à la façon de la nostalgie radieuse suivant l’orgasme » ? Henri Abril inscrit dès lors sa poésie dans l’ère nouvelle qui fait fi des interdits, des modes, nez à nez avec l’histoire alors même que peut-être il pensait naviguer à l’estime, ainsi que Guennadi Gor écrit Blocus à l’insu de ses proches qu’il veut épargner, sans même savoir si quelqu’un pourra lire un jour ses poèmes, et efface le non-écrit de l’anti-vie exclusive, seule légitime à son époque.
Les poètes ne vivent-ils pas déjà ce présent où Andromède et La Voie lactée échangent, se transforment mutuellement ? Plus l’époque nie le manifeste, plus poètes et prophètes, experts du trivial, de l’infime, du bas-côté, des ravins (Aïgui) font chorus. Le siècle piétine, refuse de commencer, répète l’échec connu. Ces invaginations, ces refus de la liberté libre stimulent, libèrent le poète qui crée le passé et le futur à neuf, l’avenir vu agençant les répétitions fertiles, atomes divers et mêlés écoutés par l’oreille du poète. À lire Henri Abril, le poète imite son timbre, sa propre poésie qui n’est qu’à travers celles des autres, sa vie et ses écrits indissociables ; Hermès n’est-il pas lui-même à travers autrui, les hommes et les dieux et les énergies qui l’excèdent?
L’imposition des lettres à l’égal des mains guérit, courant marin invisible, le sang et l’eau brassés, le corps du poète observe depuis son dedans les paysages du dehors, l’infini des conceptions en amont des langes et des orées surpris par cette méthode inusitée dégage de nouvelles régions, l’aire arpentée par les découvreurs de mondes que sont les poètes, deviennent conjurations kamtchatkales – hommes originaires de la péninsule du Kamtchatka de l’Extrême-Orient russe – le poète cueillant en course ces initiations qu’il renouvelle sans cesse afin que le gel des superstitions ne les fige pas dans le non-monde, entre la vie et la mort à jamais.
L’écrit, poème ou fulgur, de Henri Abril, a une tonalité unique, faisant du français, langue rétive, un instrument qui vibre d’une musique certaine, aromates ponctués d’une ire ionisée, l’ironisme des diatribes où le sens, les citations dévorent l’autosatisfaction, démallarmisent la langue sans renoncer à l’abstrait concis, pénétré, conflagré de vie concrète, proche d’Alejandra Pizarnik faisant sonner la langue espagnole d’Argentine d’une façon unique, Non, rien qui puisse, Alejandra Pizarnik, abolir le hasard que tu engendras prise de panique (p.131). Deviner et devenir ont parties liées dans cette résonance – tel qu’Eve Malleret traduit Le poème de la Montagne et Le poème de la fin de Marina Tsvetaïeva en français avec l’âme des deux langues en mains – où les contraintes deviennent ces jumelles, rimes, syllabes où l’on rame entre Charybde et Scylla. Contraintes dans l’art – contre l’étreinte du hasard (p.82), les rimes loin de se limiter à une simple fonction mnémotechnique, permettant de prospecter autant le sens, le dedans du sujet, les environs que sont le passé et le futur.
Peu a été dit de cet ouvrage où thèmes numérotés, espacés dans le corps des quatre parties de ce livre, Poétique, Paraproverbe, Post-utopie… proposent autant de façons de lire, de livres, de livrets dans l’ouvrage placé sous le signe de Rrose, l’érotique de Marcel Duchamp pour l’acoustique de sa causticité, de Leiris pour son timbre et le franc-jeu de son autocritique et de ses gloses, Intime Etymon déclarant une vie d’un homme, déclinant originalement une autobiographie, montages d’analepses et de prolepses inscrites dans la chair et l’esprit du poète, de Nerval rare inventeur du français oral et écrit…, au moins le lecteur peut-il signaler que le poète s’étonne de la brièveté, coup d’ailes de sa vie lorsqu’il se trouve nez à nez avec son berceau, n’ayant de cesse, dionysien dionysiaque, bachique, de dire-décrire le jeu des heurts, d’affirmer qu’aucune bassesse ni défaite ponctuelle ou collective ne peut battre en brèche l’amour qu’il porte à la vie-poésie, vie et poésie indissociables à ses yeux où les frontières entre profane et sacré sont créées, frappées du coin du vers, à neuf.
* * * *
Article de Christophe STOLOWICKI
Libr-Critique, 5 janvier 2019
Intime étymon, ce radical libre favorisant l’immunité, tout en perles de la plus belle eau qu’un poète ait portées pour les faire rosir, est un recueil de brèves notées sur quinze ans (« Ibérie / Moscovie, 1986 – 1995 ; 2012 – 2016 ») par l’exilé viscéral en résidence alternée aux deux pôles de son ascendance de sépharade et d’ashkénaze – en démenti cinglant à maints praticiens contemporains de l’aphori(s)me dont l’oulipisme d’isthme en isthme a pétri la lippe de suffisance, dont de virtuose l’audace perdue il reste l’osier. Formules hors devise, de langue plein la bouche, de celles qui s’abouchent et s’aboutent comme un grand cru de réglisse sur échasses de la pure douleur, une tragédie suspendue dans les ajours de leur codage ; à profusion de sens qui se profilent et se dédoublent et s’engendrent à échos, s’allient et se délient et se délitent à force d’alluvions allusifs en diable et en débâcle ; « en une sorte de danse rituelle ou virtuelle, à la façon de la nostalgie radieuse suivant l’orgasme » ; à coups de botte en touche le substantiel affleurant sous le fortuit ; rompu l’auteur non en place de Grève mais par un bourreau chinois aux mille tours & détours faits au tour, au compas de ses langues, dix en une – s’append et s’étrécit, au festin de Thyeste de la paronomase, la dentale, l’imprononçable, la liquide, l’allitérée, le mitoyen cours d’une vie du traducteur connu de poètes russes, Henri Abril.
Dix en une, dix au moins, dont le catalan, l’espagnol, l’ukrainien, le polonais, le lithuanien, tapis en embuscade aux abords du français et du russe, ses idiomes d’écriture, et dont les échos matelassent, décrassent, délassent en virelangue son propos ; de langue plus réversible et chargée de sens d’être imprégnée, et dont nous ne connaîtrons jamais que la partie émergée d’iceberg ; un précipité de dix en une, plus franche que franque, qu’un sosie associe, en sursis de soucis, d’ipsissime asepsie ; dans les jointures, cannelures de ses jeux de phonèmes qui se musse, se niche, nidifie ; vins de soif dont il s’est fait la bouche pour composer, de merlot et de cabernet franc, un nectar de garage ou de jardin de curé qu’à l’aveugle on déguste comme un grand cru clairvoyant.
« Il y a dans toute théorie une idée habitée par ses propres scories ». « Lave tes laves avec tes larmes. » « Trouve pour perdre. Perds pour que tout s’entrouvre », ou Jette ton pain à la face des eaux. « Fières intentions des dépravés, tout l’enfer en est dépavé. » « Tel saint s’épure ou suppure jusque dans sa sépulture. » « Propos sur la poésie : crachats du crapaud dans l’ambroisie » (le cuistre Heidegger dissertant Pourquoi des poètes). « De cercueil en fauteuil, de fauteuil en cercueil l’Académie […] l’emphase des logophages – rois de la paraphrase » (y eut-il jamais un seul grand écrivain à l’Académie française, de ceux dont les noms perforent les siècles ?) « Inoxydable innocence des noces du son et du sens. » « Certains poètes ont la peau de l’âme si transparente qu’ils vous traversent de veine à veine et vous réinventent. » « Les faits ont une autre allure avec un peu de fêlure. » Épuiser l’adversaire sous l’épaisseur du regard. « Malheureux qui revêt ce qu’un autre a rêvé » (je ne serai pas aussi intransigeant). « Ambassades à la juste croisée du sabre et de l’embrassade », ou la juste dose d’huile dans son vinaigre de Wilde revu par Sade. « Aux anges l’ex-corps réclamait une escorte », les rimes en paronymie reconduisant l’imprononçable. Du liquide au rauque (« n’ayant vécu qu’à mi-être, déjà tu t’émiettes ») les paronomases à fronts renversés. « Ne te moque pas du perroquet : qui ne serait interloqué par l’écho de son propre hoquet ? », ou la brève en abyme d’abyme maîtrisant son bégaiement existentiel.
Quand le sens ne tient qu’à un fil que trame enchaîne, sur les brisées d’Abril on s’essouffle on s’irise, de méprise en cerise sur le gâteau en miettes – sa poétique éloge parfait de l’imperfection le dispute à celle de Lautréamont. Tiré par les cheveux à quatre chevaux d’un écheveau fil à fil emmêlé, déroulé, on ne peut le comprendre qu’en l’imitant – en hémolyse d’homorimes au défaut de la cuirasse du sens, pour seule religion le nominalisme, le seul isthme qui s’étrécissant nous laisse toujours ivre de poésie comme d’un vin de messe, missa est. De son oulipo la contrainte a fait long feu de brandes, à tant de feux croisés l’exposant qu’on ne sait plus ce qui l’emporte, de la contrainte ou de l’association libre – dans son précis de dégagement les pirouettes celles d’un styli(s)te sur sa colonne. Poètes par ouï-dire disent à l’ouïe non le oui, non le non ni le mezzo voce, ni le jeu, de l’ego, du pair et de l’impair, mais un ludique fonctionnel – quand l’ouvroir d’Henri Abril, si instruit soit-il des mille jeux, est de littérature effective, rigoureuse, tragique, rarement gratuit, sinon de prodigalité encensant ses amours : Mandelstam, Essénine, Danil Harms, Tomas Venclova (lituanien), Guennadi Gor, Tsvétaïéva, Akhmatova, Khodassévitch, traduits en français fibre à fibre.
(En couverture un Baigneur nu de Malévitch, marcheur au pas gymnastique déboîté et palmé ou crawleur nu sans visage, ses membres réduits à leurs seules lignes de force compacte, de 1911, préfigure l’abstraction suprématiste, comme la série de L’homme qui court de 1933 (cf. photo ci-dessus) en post-figure l’extinction sous le révolver braqué de Staline. De même violence d’abolition de la perspective et du visage humain).
***
Extrait (début du livre)
La monade fondant mon nom, c’est un nomade fondu à l’herbe, au sable, et qui célèbre ses démons.
*
D’un œuf de quelle hydre, Seigneur, est née l’idée neuve du bonheur ?
*
Pulpe de l’anagramme, catapulte mon âme sur l’agora des onagres.
*
Depuis toujours otage d’un autre âge, hors du temps où l’on naît et gît, je n’aurai nostalgie que des dieux jetant un os à nos orgies.
*
L’étoffe des rêves nous étouffe ou nous innerve. Mais bienvenue la sève du rêve le plus nu.
*
Saint-Pol, roux coquelicot, dans quel lit à l’aube ton chant de coq laissait-il un écho ?
*
Malheureux qui revêt ce qu’un autre a rêvé.
*
Vestales, de vos tiges si vertes il n’est resté que des vestiges. Pourtant, l’homme en a toujours le vertige.
*
Savoir mûrir pour se voir mourir ? Défense de défroisser l’enfance.
*
Au fond de toi, anonyme, l’âme qui ânonne et que tu mimes.
*
Toute connaissance ne prend sens que par la goutte de sang qui lui donna naissance. Quand le sens croît du son, croyez-moi, sanglante est la moisson.
*
De quel ange ou saint es-tu enceinte, ma sœur de fange et d’absinthe ?
*
Liés comme le verbe et le songe, comme le vrai et le faux. Herbe de vérité, le mensonge est ta faux.
*
Variation
Vérité : déjà le ver y est entré. Verve de l’été au creux de l’hiver. Tu as tout faux, pensée aphone d’un monde de vrais faunes.
*
Qui se ressemble s’assemble puis s’ensable. Dans l’accessoire, le seul accès à soi.
*
Fugue du déluge, contre-fugue du refuge : j’aime dans l’Arche la douceur des archets, comme si le cœur de Noé s’y était dénoué.
*
Orphique
Leçon de ténèbres quand sous l’herbe renaît le son éteint de l’Hèbre.
*
Qui pour un diable humain a milité, en a-t-il plus d’humilité ? De l’orgueil à la morgue, rien qu’un pas que la mort cueille.
