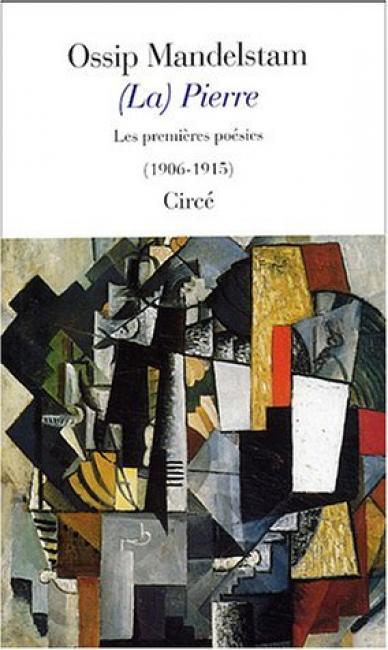
Ossip Mandelstam
Les premières poésies (1906-1915)
« Mandelstam n’a pas eu de maître… Nous sommes au fait des origines de Pouchkine et de Blok, mais qui pourrait dire d’où est venue cette harmonie nouvelle et supérieure qui a pour nom : les poèmes d’Ossip Mandelstam ? », a écrit Anna Akhmatova, et tel pouvait en effet être le sentiment inspiré aux lecteurs par (La) Pierre, le premier livre du poète à peine âgé de 22 ans, dont la voix apparut d’emblée singulière, reconnaissable entre toutes. Les nombreux textes écrits entre 1906 et 1915, pour la plupart inédits jusque-là en français, permettent toutefois de mieux éclairer la « préhistoire » de Mandelstam.
Dès le début, sa démarche poétique allait au-delà du symbolisme et de la musicalité verlainienne, mais aussi de l’acméisme, le mouvement auquel il fut amené à participer, à partir de 1912, aux côtés de Nikolaï Goumiliov et d’Anna Akhmatova. Mandelstam est le premier chez qui le mot apparaît comme l’unité insécable, autonome et suffisante, de l’acte poétique, comme la base d’une nouvelle architecture verbale « réifiée », et son évolution ultérieure va notamment consister à en tirer toutes les conséquences paradigmatiques. « Son œuvre est à l’opposé du classicisme et de l’avant-garde, tout en restant infiniment proche de l’un et de l’autre » : ce paradoxe énoncé par Sergueï Avérintsev caractérise on ne peut mieux la position exceptionnelle de Mandelstam au cœur de la poésie russe du vingtième siècle. Avec pour toile de fond sa traversée tragique de l’histoire, jusqu’à la mort dans un camp de transit du Goulag en décembre 1938.
Le présent volume et les trois autres déjà parus aux éditions Circé (Le Deuxième Livre, 1916-1925 ; Les Poèmes de Moscou, 1930-1934 ; Les Cahiers de Voronej, 1935-1937) constituent la première édition complète, bilingue et commentée, de l’œuvre poétique d’Ossip Mandelstam ».
Un corps m’est échu : qu’en ferai-je enfin,
Tellement unique et tellement mien ?
La douce joie de vivre et respirer,
D’où me vient-elle, et qui en remercier ?
Étant fleur et jardinier à la fois,
Je ne suis seul dans la geôle ici-bas.
Et sur la vitre de l’éternité
Ma chaude haleine a pu se déposer.
Ses empreintes, comme des ornements,
Déjà se déchiffrent malaisément.
Que l’instant s’envole avec la buée !
Mon cher dessin, rien ne peut l’effacer.
1909
Silentium
Elle n’est pas encore née,
Elle est la musique et le verbe
Et donc le lien nouant les gerbes
De toute vie, jamais brisé.
Les seins de la mer en mesure
Respirent dans le jour dément,
Trop clair : l’écume en lilas blanc
Dans un vase d’encre et d’azur…
Qu’à mes lèvres vienne à nouveau
La mutité des origines,
La note pure et cristalline
Qui était née avant les mots.
Reste, Aphrodite, écume blonde,
Verbe, retourne à la musique,
Et sache, ô cœur, être pudique,
Fondu à la trame du monde !
1910
Le coquillage
Pour toi ma vie importe-t-elle,
Nuit ? Comme un vide coquillage,
Hors de l’abîme universel
J’ai échoué sur ton rivage.
Ton flot moutonne, et tu n’y songes,
Tu chantes sans rien écouter,
Mais tu aimeras le mensonge
Du coquillage déserté.
Près de lui tu t’allongeras,
Le vêtiras de ta chasuble,
La cloche des houles tiendra
À lui d’un lien indissoluble.
Le frêle coquillage, ensuite,
Tu l’empliras d’un bruit d’écume
— Comme un cœur que plus rien n’habite —,
De vent, et de pluie, et de brume…
1911
*
Nuit d’insomnie. Homère. Et voiles qui se tendent.
Je n’ai lu qu’à moitié la liste des vaisseaux :
Cette longue nichée, cette nuée d’oiseaux
Qui d’Hellade un beau jour s’envolèrent en bande.
Flèche de grues dardée vers des terres lointaines
— Une divine écume couronnant les rois —,
Où voguez-vous ainsi ? Que serait pour vous Troie,
O mâles Achéens, s’il n’y avait Hélène ?
Et Homère, et les flots, tout est mû par l’amour.
Qui faut-il écouter ? Mais Homère se tait
Et la mer a noirci, et près de mon chevet
Je l’entends qui déferle en pérorant toujours.
1915

